L’Actu vue par Remaides : « 28 juillet, journée mondiale contre les hépatites »
- Actualité
- 28.07.2025
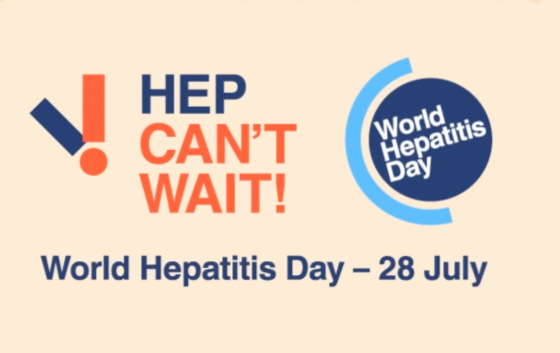
Crédit photo : DR.
Par Jean-François Laforgerie
28 juillet, journée mondiale
contre les hépatites
En France, près de 270 000 personnes souffrent d’une hépatite virale, et notamment d’hépatites B et C. Chaque année, le 28 juillet, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) mobilise les acteurs-rices des soins contre les hépatites. L’occasion de parler de ces maladies et de leur prise en charge. Les hépatites virales sont, dans le monde, la deuxième cause de décès dû à une maladie infectieuse, selon l’OMS.
Une journée mondiale sur les hépatites, le 28 juillet
La Journée mondiale contre l’hépatite, le 28 juillet, est l’occasion d’intensifier les efforts internationaux de lutte contre cette maladie, d’encourager l’engagement des individus, des partenaires et du grand public, ainsi que de souligner le besoin d’une riposte mondiale plus énergique, telle qu’elle est décrite dans le Rapport mondial de l’OMS sur l’hépatite publié en 2017.
Cette année, cette journée de mobilisation a pour thème : « Hépatite : faisons tomber les barrières ! ».
Pourquoi cette journée a-t-elle lieu chaque 28 juillet ?
La date du 28 juillet a été retenue car elle correspond à celle de la naissance du lauréat du Prix Nobel, le Dr Baruch Blumberg, qui a découvert le virus de l’hépatite B et mis au point un test et un vaccin contre ce virus.
Comme l’explique l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la principale lacune à combler a trait à la faible couverture du dépistage et du traitement pour atteindre les buts mondiaux de l’élimination d’ici à 2030.
Quelques données mondiales :
- environ 304 millions de personnes vivaient avec une hépatite B ou une hépatite C chronique en 2022 ;
- seuls 45 % des nourrissons ont été vaccinés contre l’hépatite B dans les 24 heures suivant leur naissance en 2022 ;
- 1,3 million de personnes sont décédées de l’hépatite B ou de l’hépatite C chronique en 2022.
Quel impact des hépatites virales ?
Les hépatites sont l’une des principales causes de cancer du foie et une cause de décès de plus en plus importante dans le monde.
Les hépatites virales chroniques sont à l’origine de 1,3 million de décès par an, principalement dus au cancer du foie et à la cirrhose. Cela représente 3500 décès par jour, soit autant que pour la tuberculose. La transmission des hépatites B et C passe inaperçue et on compte 6000 nouvelles infections par jour. Alors qu’il est possible d’éviter et de traiter ces maladies, la charge de morbidité continue d’augmenter, en particulier dans les régions où l’accès aux soins est limité.
Pour prévenir le cancer du foie, il faut d’abord connaître son état de santé.
La plupart des personnes atteintes d’hépatite ignorent qu’elles le sont. Un diagnostic précoce est essentiel pour avoir accès à un traitement vital et pour prévenir le cancer du foie. Le dépistage, en particulier pour les personnes vivant dans des régions d’endémie ou où le risque est élevé, est essentiel pour mettre fin à l’hépatite.
Il est possible d’éviter 2,8 millions de décès d’ici à 2030, mais seulement si les pays agissent immédiatement.
L’élimination de l’hépatite est à portée de main. Nous disposons de vaccins, de traitements curatifs et d’outils éprouvés pour enrayer la transmission. La plupart des cas sont diagnostiqués trop tard. Pour progresser, il faut pouvoir compter sur un engagement national, des investissements judicieux et des systèmes de santé publique qui intègrent les services de lutte contre l’hépatite dans les soins primaires. Investir dans le diagnostic précoce et dans des soins intégrés et centrés sur la personne permettra de sauver des vies et de prévenir les cas de cancer.
Le plan d’action de l’OMS pour « Éliminer l’hépatite pour éviter les décès et prévenir le cancer du foie », voici les recommandations de l’institution :
À l’intention du grand public :
- Faire un test de dépistage des hépatites B et C ;
- Faire vacciner les nouveau-nés contre l’hépatite B dans les 24 heures suivant la naissance ;
- Prendre des informations fiables et parlez du dépistage et du traitement précoces avec un(e) soignant(e) ;
- Lutter contre la stigmatisation en diffusant des informations correctes.
À l’intention des décideurs-ses et des pouvoirs publics :
- Diriger et financez des campagnes de sensibilisation liant l’hépatite à la prévention du cancer du foie ;
- Vacciner davantage de nouveau-nés contre l’hépatite B à la naissance, et veillez à la sécurité des transfusions et des infections et à la réduction des risques ;
- Développer le dépistage et le traitement abordables et décentralisés intégrés dans les soins primaires dans tous les services de santé, y compris ceux de prise en charge de l’infection à VIH et d’autres maladies transmissibles et non transmissibles, de lutte contre le cancer et de santé de la mère et de l’enfant ;
- Intégrer les services de lutte contre l’hépatite dans la couverture sanitaire universelle et les régimes nationaux d’assurance ;
- Mobiliser toutes les parties prenantes et investissez dans des systèmes de données fiables pour plus de transparence.
À l’intention des autorités sanitaires nationales :
- Donner la priorité au diagnostic et au traitement précoces, surtout dans les communautés mal desservies et celles où la charge de morbidité est élevée ;
- Décentraliser les services vers les centres de santé primaires et de district ;
- Intégrer la prévention de l’hépatite dans les programmes de santé de la mère et de l’enfant ;
- Assurer un accès gratuit ou universel au dépistage et au traitement ;
- Mobiliser un financement durable et utilisez les données pour favoriser les progrès.
Hépatite B : les principaux faits
L’hépatite B est une infection virale qui s’attaque au foie et peut entraîner une affection aussi bien aiguë que chronique.
Le virus responsable est le plus souvent transmis par la mère à l’enfant lors de la naissance et de l’accouchement, pendant la petite enfance, ou par contact avec du sang ou d’autres liquides biologiques lors d’un rapport sexuel avec un partenaire infecté, d’injections à risque ou d’une exposition à des instruments tranchants ou piquants. Pour être précis, le virus de l’hépatite B se transmet par les piqûres d’aiguilles, les tatouages, les piercings et l’exposition à du sang ou à des liquides biologiques infectés comme la salive, les écoulements menstruels, les sécrétions vaginales ou le liquide séminal. Il peut aussi se transmettre lors de la réutilisation d’aiguilles, de seringues ou d’objets tranchants ou piquants contaminés dans les établissements de soins, dans la communauté ou chez les consommateurs de drogues injectables. La transmission sexuelle est plus prévalente chez les non-vaccinés-es ayant des partenaires sexuels multiples.
Chez l’adulte, une infection par le virus de l’hépatite B débouche sur une hépatite chronique dans moins de 5 % des cas, tandis que chez les nourrissons et les jeunes enfants, elle provoque l’apparition d’une forme chronique de la maladie dans environ 95 % des cas. Il ressort de ce constat qu’il faut renforcer la vaccination des nourrissons et des enfants et en faire une priorité.
L’OMS estime que 254 millions de personnes vivaient avec une hépatite B chronique en 2022 et l’on dénombre 1,2 million de nouvelles infections chaque année. En 2022, l’hépatite B a provoqué environ 1,1 million de décès, principalement par cirrhose ou par carcinome hépatocellulaire (cancer primitif du foie). On dispose cependant de vaccins sûrs et efficaces pour prévenir l’hépatite B.
Le virus de l’hépatite B peut survivre à l’extérieur du corps pendant sept jours au moins. Au cours de cette période, il peut encore provoquer une infection s’il pénètre dans l’organisme d’une personne non protégée par le vaccin. Sa période d’incubation varie de 30 à 180 jours. Il est détectable sur une durée allant de 30 à 60 jours après l’infection et peut persister dans l’organisme en donnant lieu à une hépatite B chronique, en particulier lors d’une transmission au nourrisson ou à l’enfant.
Environ 1 % des personnes vivant avec le VHB (2,7 millions) sont aussi infectées par le VIH. Inversement, la prévalence mondiale de l’infection par le VHB des personnes infectées par le VIH est de 7,4 %. Depuis 2015, l’OMS recommande de traiter toute personne diagnostiquée comme porteuse du VIH, indépendamment du stade de la maladie. Le ténofovir, inclus dans les associations thérapeutiques recommandées comme traitement de première intention des infections à VIH, est également efficace contre le VHB.
Source : OMS, avril 2024
Hépatite C : les principaux faits
L’hépatite C est une inflammation du foie provoquée par le virus de l’hépatite C (VHC).
L’infection par ce virus peut entraîner une maladie aigüe ou chronique et se manifester par des formes bénignes aussi bien que par une maladie grave qui s’installe à vie, comme la cirrhose ou le cancer.
Le virus de l’hépatite C est transmis par le sang : l’exposition à du sang contaminé constitue le mode d’infection le plus courant, notamment lors de pratiques d’injection ou de soins de santé à risque, de transfusions de sang n’ayant pas fait l’objet d’un dépistage, de la consommation de drogues par injection ou de pratiques sexuelles entraînant une exposition au sang.
À l’échelle mondiale, on estime à 50 millions le nombre des porteurs et de porteuses chroniques du virus de l’hépatite C et à 1,0 million environ celui des nouvelles infections survenant chaque année. L’OMS estime à environ 242 000 le nombre des décès dus à l’hépatite C en 2022, pour la plupart consécutifs à une cirrhose ou un carcinome hépatocellulaire (cancer primitif du foie).
Les infections aiguës par le VHC sont habituellement asymptomatiques et ne conduisent pas la plupart du temps à une maladie potentiellement mortelle. Chez environ 30 % (15 % à 45 %) des personnes infectées, le virus est spontanément éliminé dans les six mois qui suivent l’infection, sans aucun traitement. Pour les 70 % restants (55 % à 85 %), l’infection évoluera vers une forme chronique. Chez les malades chroniques, le risque de cirrhose est de 15 % à 30 % dans les 20 ans qui suivent l’infection.
Des antiviraux à action directe (AAD) permettent de guérir plus de 95 % des personnes infectées par le virus de l’hépatite C, mais l’accès au diagnostic et au traitement est limité au plan mondial. Il n’existe actuellement aucun vaccin contre l’hépatite C, mais la maladie peut être traitée et guérie par des antiviraux. La détection et le traitement précoces peuvent éviter de graves atteintes hépatiques et améliorer la santé à long terme. Des antiviraux, notamment le sofosbuvir et le daclatasvir, sont utilisés contre l’hépatite C. Chez certaines personnes, le système immunitaire parvient à combattre l’infection et les infections nouvelles n’appellent pas toujours un traitement. En revanche, un traitement est toujours nécessaire en cas d’hépatite C chronique.
L’OMS recommande un traitement par antiviraux à action directe (AAD) pangénotypiques pour l’ensemble des adultes, des adolescents et des enfants atteints d’hépatite C chronique à partir de l’âge de trois ans. Les schémas thérapeutiques oraux de courte durée par AAD n’ont que peu ou pas d’effets secondaires. Les AAD permettent de guérir la plupart des personnes présentant une infection à VHC et le traitement est de courte durée ― habituellement 12 à 24 semaines, selon la présence ou non d’une cirrhose. En 2022, l’OMS a formulé de nouvelles recommandations pour le traitement des adolescents et des enfants à l’aide des mêmes antiviraux à action directe pangénotypiques que ceux utilisés pour les adultes.
L’accès au traitement contre le VHC s’améliore, mais il reste encore limité. On estime que 36 % des 50 millions de personnes vivant avec une infection à VHC dans le monde en 2022 connaissaient le diagnostic et que parmi celles diagnostiquées comme porteuses d’une infection à VHC chronique, 20 % environ (12,5 millions) avaient reçu des AAD avant que l’année ne s’achève.
Source : OMS, avril 2024
Hépatite A : les principaux faits
L’hépatite A est une inflammation du foie dont l’évolution peut être bénigne ou grave.
Le virus de l’hépatite A (VHA) se transmet par ingestion d’eau ou d’aliments contaminés ou par contact direct avec une personne infectée.
Presque toutes les personnes qui contractent une hépatite A en guérissent complètement, et sont ensuite immunisées à vie. Néanmoins, une très faible proportion des sujets infectés par le VHA peut décéder des suites d’une hépatite fulminante. Le risque d’infection par le VHA est lié au manque d’eau potable et à la médiocrité des conditions d’assainissement et d’hygiène (mains infectées et sales, par exemple).
Il existe un vaccin sûr et efficace pour prévenir l’hépatite A.
Source : OMS, juillet 2023
Hépatite D : les principaux faits
Le virus de l’hépatite D (VHD) a besoin de celui de l’hépatite B (VHB) pour pouvoir se répliquer. L’infection chronique par le VHD ne touche que les personnes vivant avec le VHB.
À l’échelle mondiale, le VHD touche près de 5 % des personnes présentant une infection chronique par le VHB.
Parmi les populations les plus susceptibles de présenter une co-infection par le VHB et le VHD figurent les populations autochtones, les personnes hémodialysées et les personnes qui s’injectent des drogues.
L’infection chronique par le VHD est considérée comme la forme la plus grave d’hépatite virale chronique en raison de l’évolution rapide vers la mort par atteinte hépatique et carcinome hépatocellulaire.
La prévention de l’hépatite D passe par la vaccination contre l’hépatite B.
De nouvelles options de traitement présentant de meilleurs profils d’innocuité et offrant de meilleurs résultats ont été approuvées en Europe.
Source : OMS, avril 2025
Hépatite E : : les principaux faits
L’hépatite E est une inflammation du foie provoquée par une infection par le virus de l’hépatite E (VHE).
En 2021, le VHE a causé 3450 décès et environ 19,47 millions de cas d’hépatite E aiguë dans le monde. Il représentait alors 5,4 % des années de vie ajustées sur l’incapacité (DALY) liées à une hépatite aiguë à l’échelle mondiale (1).
Le virus se transmet par voie fécale-orale, principalement par de l’eau contaminée.
L’hépatite E est présente dans le monde entier, mais c’est en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est qu’elle est la plus courante.
Un vaccin permettant de prévenir l’infection par le VHE est homologué en Chine et dans d’autres pays et est utilisé comme mesure de riposte aux épidémies.
Source : OMS, avril 2025
SOS Hépatites & maladies du foie : « Il faudra encore combien d’Ardisonneries ? »
« Il faudra encore combien d’Ardisonneries pour qu’on réagisse ? », interroge le Dr Pascal Mélin, président de la Fédération SOS hépatites & maladies du foie, dans un communiqué (24 juillet).
« Le 28 juillet, c’est la Journée mondiale de lutte contre les hépatites virales et l’actualité nous rappelle son importance avec le décès de Thierry Ardisson des suites d’un cancer du foie pour avoir guéri trop tard de son virus de l’hépatite C, explique le médecin. Oui, aujourd’hui on guérit de l’hépatite C dans plus de 97 %, mais pas de la fibrose. Ainsi, en cas de fibrose sévère et de cirrhose la guérison du virus de l’hépatite C n’évite pas l’apparition d’un éventuel cancer du foie. Dépisté et pris en charge à temps il est guérissable mais à un stade avancé la maladie est mortelle. En 40 ans, en France on est passé de 400 000 personnes infectées à 60 000 (un Français sur 1 000 reste infecté), mais 20 % des personnes traitées l’ont été à un stade de cirrhose et le risque de cancer reste une épée de Damoclès ! »
Pour le médecin, la « France est en panne dans son plan de lutte contre l’hépatite C, il faut redynamiser le dépistage afin d’éviter les complications de la cirrhose. C’est maintenant qu’il faut agir si l’on veut respecter l’objectif de l’OMS d’éliminer les hépatites virales pour 2030 (…) Si l’on poursuit la stratégie actuelle, c’est un échec certain ! » Et le médecin de conclure : « Dans les pays riches comme la France au-delà des virus, c’est contre la fibrose hépatique, la cirrhose et les maladies du foie en général qu’il faut se mobiliser. SOS hépatites & maladies du foie interpelle urgemment les pouvoirs publics pour ne pas abandonner les malades du foie. Le 28 juillet, (…) on ne peut pas se satisfaire d’un spot radio d’incitation au dépistage, nous attendons un engagement fort sans quoi nous risquons de voir apparaitre une nouvelle vague d’hépatite C et l’explosion des cancers du foie. C’est l’affaire de tous et c’est l’affaire d’aujourd’hui, arrêtons les "Ardissonneries" ! »
