L'Actu vue par Remaides : L’Endroit de mon trouble : Un roman queer qui explore les frontières du désir et de l'identité
- Actualité
- 23.04.2025
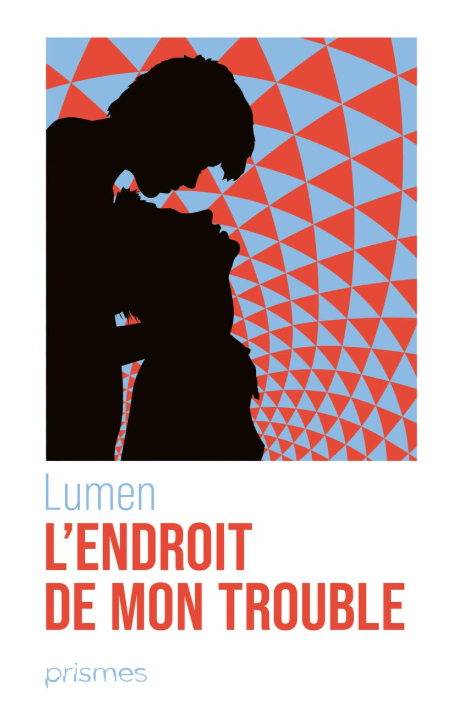
Crédit image : Éditions La Musardine/Collection « Prismes »
Par Fred Lebreton
"L'endroit de mon trouble" : Un roman queer qui explore les frontières du désir et de l'identité
Avec L’Endroit de mon trouble, son tout premier roman publié chez La Musardine dans la collection « Prismes » dirigée par Didier Roth-Bettoni — figure incontournable du journalisme et du cinéma LGBT+ — Lumen fait une entrée remarquée en littérature. L’Actu vue par Remaides vous propose de découvrir cette nouveauté, suivie de trois autres lectures essentielles : Une histoire mondiale du sida (1981-2025) de Marion Aballéa, La santé est politique de Miguel Shema, et Ce que Grindr a fait de nous de Thibault Lambert.
"L'endroit de mon trouble" : Un roman queer qui explore les frontières du désir et de l'identité
Avec L’Endroit de mon trouble, l’artiste queer pluridisciplinaire Lumen livre un premier roman à la fois sensuel, politique et profondément intime. À travers l’histoire de Vex, thérapeute, et Mikka, travailleuse du sexe, ce récit érotique bouscule les représentations traditionnelles du couple et du désir. Leur relation, à la fois libre et fusionnelle, mêle jeux de rôle, fluidité des genres, défis pornos et partage émotionnel intense.
Ensemble, « iels » réinventent les codes amoureux en brouillant volontairement les frontières entre fantasme et réalité, sexualité et thérapie, plaisir et exploration identitaire. « Et si ce qui fait excitation chez nous était bien plus vaste que ce que nous avions imaginé ? » questionne le roman, comme un fil conducteur qui traverse ce voyage littéraire sans tabous. Lumen y déploie une langue à la fois crue et suave, reflet d’un regard artistique affuté par quinze ans de travail autour des sexualités et des identités, entre la scène, l’écriture et les ateliers thérapeutiques. Publié aux éditions La Musardine dans la collection « Prismes », dirigée par Didier Roth-Bettoni, figure du journalisme et du cinéma LGBT+, ce livre s’inscrit dans un projet éditorial fort : faire exister une littérature érotique queer au sein d’un paysage éditorial souvent centré sur l’hétérosexualité. « Il n'y a plus beaucoup de maisons d'édition purement LGBT aujourd’hui, et très peu qui parlent de sexualité », rappelle Didier Roth-Bettoni, soulignant l’importance de maintenir cette parole vivante dans les communautés LGBTQI. Pour le journaliste et éditeur, L’Endroit de mon trouble est « un formidable premier roman queer, lesbien, BDSM et beaucoup d’autres choses », un texte puissant qui affirme que la sexualité reste un terrain politique et poétique essentiel.
L'endroit de mon trouble/Éditions La Musardine/Collection « Prismes »/18 euros.
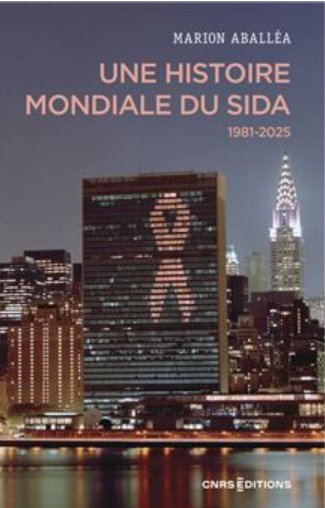
Crédit image : Éditions du CNRS
"Une histoire mondiale du sida" : un récit social, politique et scientifique d'une pandémie hors normes
Dans Une histoire mondiale du sida (1981-2025), publié aux éditions du CNRS, l’historienne Marion Aballéa explore la trajectoire inédite de cette pandémie, à la fois sanitaire, politique et sociale. Depuis la première alerte en juin 1981 à Los Angeles, où cinq jeunes homosexuels sont diagnostiqués d’une pneumocystose rare, jusqu’à la menace actuelle d’un retour en arrière lié au retrait des financements américains, l’autrice retrace comment le VIH/sida est devenu un fait politique, culturel et économique mondial. Elle insiste sur le choc initial et la stigmatisation des malades – qualifiés de victimes du « cancer gay » – et sur la lenteur des réponses institutionnelles, comblée par une mobilisation exceptionnelle des personnes concernées, devenues de véritables « malades experts ». « Le militantisme, c’est d’abord un réflexe d’auto-défense », souligne l’autrice, saluant la force de réseaux comme Act Up-Paris. Le tournant thérapeutique des trithérapies en 1996 marque un basculement de la condamnation à une vie possible avec le virus, mais reste à l’époque inaccessible dans les pays du Sud. Il faudra attendre les années 2000 et des programmes comme le PEPFAR pour élargir cet accès. Aujourd’hui, l’oubli progressif de la crise, notamment en Occident, et la suspension en 2024 de la majorité des aides américaines fragilisent les progrès réalisés. « Des gens dépendent au quotidien des traitements pour leur survie et s’interrogent pour savoir si demain ils auront encore ce traitement », alerte Marion Aballéa, dans un entretien accordé à France Inter.
Une histoire mondiale du sida (1981-2025)/Éditions du CNRS/18 euros.
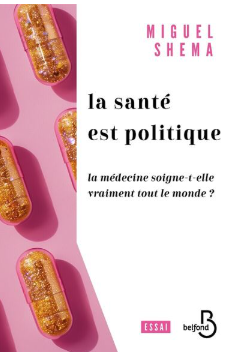
Crédit image : Belfond
"La santé est politique" : Miguel Schema dénonce les biais racistes et sociaux du système de santé
Dans La santé est politique (Belfond), Miguel Shema, étudiant en cinquième année de médecine, dresse un constat sans appel : loin d’être neutre, l’institution médicale française est traversée par des biais racistes, sexistes, classistes et LGBTphobes. Fort de sa double formation en sociologie et en médecine, il interroge une médecine prétendument universelle qui, en réalité, laisse de côté les plus vulnérables. L’épidémie de Covid, les violences gynécologiques, ou encore la persistance du « syndrome méditerranéen » – ce cliché raciste qui pousse à minimiser la douleur des patientes racisées – en sont les symptômes les plus criants. « Pourquoi est-ce un article de presse qui m’a informé sur ces préjugés racistes ? », s’interroge-t-il dans un entretien à Médiapart, en évoquant l'absence de formation sur ces sujets à la faculté. Il rapporte des croyances tenaces, comme « les Noir·es résisteraient mieux à la douleur » ou « les Asiatiques seraient plus stoïques », aux conséquences directes sur les soins. Dans les faits, les patients-es noirs-es reçoivent moins d’antalgiques et sont jugés-es moins prioritaires à situation clinique identique. Son ouvrage, nourri d’études et de témoignages de terrain, entend briser l’omerta sur une médecine encore aveugle à ses propres mécanismes de domination.
La santé est politique/Belfond/20 euros
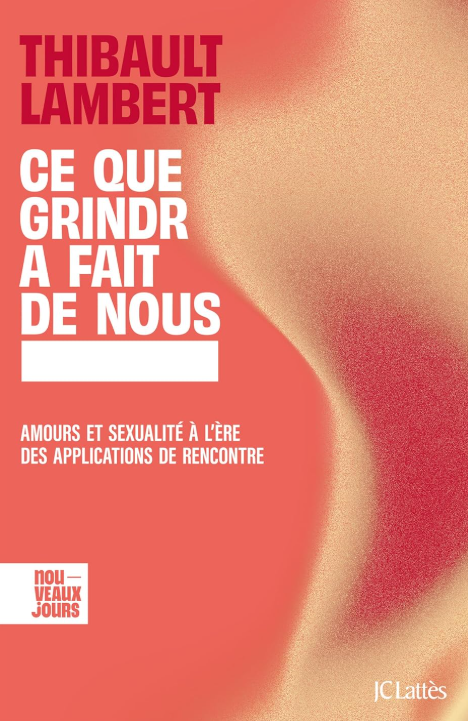
Crédit image : JC Lattès
"Ce que Grindr a fait de nous" : une enquête intime et lucide sur la sexualité gay à l'ère des applis
Quinze ans après sa création, Grindr continue de structurer les vies sexuelles et affectives de millions d’hommes gays, bisexuels ou queers. À la fois miroir et moteur d’une culture du « plan cul », l’application fascine autant qu’elle dérange, cristallisant les critiques sur l’hypersexualisation, l’exclusion raciale ou la marchandisation des corps. Dans Ce que Grindr a fait de nous (JC Lattès), le journaliste Thibault Lambert, 29 ans, interroge sa propre trajectoire à travers l’application, tout en recueillant les récits d’autres utilisateurs et les analyses de sociologues, médecins ou psychologues. « Grindr est peut-être devenu un symptôme du malaise d’une communauté qui peine encore à panser ses blessures », observe-t-il. Loin de tout jugement, son enquête explore les paradoxes d’un outil à la fois libérateur et oppressant, révélateur d’inégalités de genre, de race et de classe qui traversent les interactions. Avec sensibilité, Thibault Lambert pose la question de ce que ces usages disent de nos solitudes et de nos désirs à l’ère numérique.
Ce que Grindr a fait de nous/JC Lattès/20 euros
