L’Actu vue par Remaides : « OMS : accord historique pour faire face aux futures pandémies »
- Actualité
- 26.04.2025
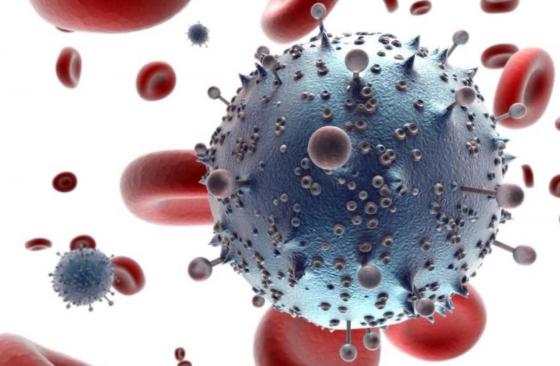
DR.
Par Jean-François Laforgerie
OMS : un accord historique pour faire face aux futures pandémies
Ouf ! Après plus de trois ans de négociations, les pays membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont approuvé, mercredi 16 avril, par consensus, un texte historique visant à mieux se préparer et lutter contre les futures pandémies. Explications.
En fin d’article, d’autres infos Monde.
« Vous avez écrit l’histoire », a déclaré, dans un accès de lyrisme, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aux délégués-es, le 16 avril dernier. Pour l’OMS, ses États membres « ont fait un grand pas en avant dans les efforts visant à rendre le monde plus sûr face aux pandémies, en élaborant un projet d’accord » qui devra encore être formellement approuvé lors de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé en mai. L’ensemble du texte a été validé en plein nuit après une ultime négociation marathon de près de 30 heures, souligne l’AFP. Déjà complexes, les discussions ont pâti du contexte de crise du système de santé mondial, provoqué par les coupes drastiques dans l’aide internationale américaine décidées par Donald Trump, et de menaces de droits de douane américains sur les médicaments. Les États-Unis étaient absents des négociations, le président américain ayant décidé qu’ils quittaient l’organisation. Cinq ans après l’arrivée de la Covid-19, des millions de morts et une économie mondiale dévastée, l’accord doit permettre de mieux préparer le monde, loin d’être équipé pour affronter une autre pandémie, selon l’OMS et les experts-es. « La conclusion des négociations (...) représente une étape importante dans notre engagement collectif à renforcer la sécurité sanitaire mondiale. Bien que le processus n’ait peut-être pas donné tous les résultats escomptés, il a ouvert une voie importante pour la collaboration future dans nos efforts pour être mieux préparés à faire face à d’éventuelles pandémies », a déclaré le représentant de la Tanzanie au nom de 77 pays du groupe régional africain, devant les délégués-es. Sur X, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également salué le consensus : « Nous avons tiré les leçons de la Covid. Pour vaincre une pandémie, il faut des tests, des traitements et des vaccins. Mais il faut aussi de la solidarité et de la coopération mondiale ». Les négociations ont été longue parce qu’elles ont buté (jusqu’au bout) sur le transfert de technologies pour la production de produits de santé liés aux pandémies, en particulier au profit des pays en développement. Le sujet avait été au cœur des nombreux griefs des pays à revenus faibles ou intermédiaires lors de la pandémie de Covid-19, quand ils voyaient les pays riches accaparer les doses de vaccin et autres tests, alors que des millions de malades étaient au sud. Plusieurs pays, où l’industrie pharmaceutique pèse lourd dans l’économie, sont opposés à l’idée d’obligation de transfert et insistent sur son caractère volontaire. Un consensus a finalement émergé autour du principe de transfert de technologies « convenu d’un commun accord ». Considéré comme une des pièces centrales du texte, ce dernier prévoit la création d’un « Système d’accès aux agents pathogènes et de partage des avantages », à savoir les produits de santé découlant de leur utilisation, comme des vaccins ou des tests par exemple. Le texte vise aussi à élargir l’accès à ces produits en établissant un réseau mondial de chaîne d’approvisionnement et de logistique. Pour Michelle Childs, directrice à l’Initiative Médicaments contre les maladies négligées (DNDi), qui a suivi de près les négociations, « les pays ne doivent pas attendre l’adoption formelle de l’accord en mai pour agir ». « Le véritable test consistera à voir si les gouvernements prennent rapidement des mesures concrètes pour élaborer des politiques nationales ambitieuses qui traduiront leurs engagements », a-t-elle développé dans un communiqué de son institution. En ce qui concerne la mise en œuvre de l’accord, la principale organisation du secteur pharmaceutique a mis l’accent sur la propriété intellectuelle et la sécurité juridique, les jugeant essentielles si l’industrie devait investir dans une recherche très risquée financièrement lors de la prochaine crise.
En bref, d'autres infos Monde
Santé : l'OCDE s'inquiète de l'avenir de l'aide internationale
L’OCDE (l’Organisation de coopération et de développement économiques) s’est inquiétée mercredi 16 avril d’une baisse future de l’aide au développement dans le monde, déjà en recul l’an dernier pour la première fois en six ans. Et cela à l’heure où les États-Unis ont entamé leur désengagement massif en matière d’aide internationale. « Cela aura un impact sur les pays partenaires, et cet impact les affectera lourdement », a affirmé Pilar Garrido, directrice de la coopération pour le développement à l’OCDE, interrogée sur les décisions récentes prises par Donald Trump. De premières estimations effectuées par l’OCDE entrevoient une chute de l’aide publique au développement (APD) ― comprise entre – 9 % dans l’hypothèse basse et – 17 % dans un scénario pessimiste ― entre 2024 et 2025. Cette dernière hypothèse représenterait la pire chute annuelle depuis que ces statistiques existent, pointe l’AFP. Ces prévisions ont été réalisées à l’heure du brutal revirement de politique entamé par Donald Trump, qui a engagé une réduction drastique de l’aide humanitaire, supprimant 92 % des financements de programmes à l’étranger de l’agence américaine de développement Usaid. Comme le rappelle l’AFP, ces coupes causeront tant des fermetures de cliniques fournissant des soins pré et post-nataux, que des arrêts de programmes de planning familial et d’accès à des avortements sécurisés, ou encore la fin des distributions alimentaires pour les femmes enceintes et allaitantes. Jusqu’ici grand pourvoyeur d’aide internationale, Washington s’est aussi retiré de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui va devoir diminuer son budget d’un cinquième à la suite de cette décision, réduisant ses missions et son personnel. « Si les gouvernements continuent à réduire l’aide, davantage d’enfants iront se coucher le ventre vide, davantage de personnes mourront de maladies que nous savons prévenir depuis longtemps, et des millions d’autres seront encore plus profondément enfoncés dans la pauvreté », a fustigé Salvatore Nocerino, responsable de la politique d’aide au sein de l’ONG Oxfam International, dans une déclaration transmise à l’AFP. Au-delà des États-Unis, « les pays donateurs sont confrontés à des pressions budgétaires importantes dues à des priorités de dépenses concurrentes », a affirmé au cours de la conférence de presse le secrétaire général de l’OCDE Mathias Cormann, citant le vieillissement de la population et les dépenses de défense. « Les annonces récentes de certains membres du comité d’aide au développement de l’OCDE, qui rassemble les grands pays donateurs) suscitent des préoccupations quant aux niveaux futurs de l’APD », a indiqué l’OCDE qui « examine l’ampleur et les conséquences de ces coupes budgétaires ». En 2024, les montants consacrés à l’aide publique au développement ont atteint 212,1 milliards de dollars, soit un recul de 7,1 % par rapport à l’année précédente, a indiqué l’OCDE dans son rapport.
Asile : l’Union européenne liste des pays « sûrs »
L’Union européenne a établi mercredi 16 avril une liste de pays d’immigration dits « sûrs », limitant de fait les possibilités d’asile pour leurs ressortissants-es, une décision critiquée par les défenseurs-ses des droits des personnes migrantes. Bruxelles est sous pression pour durcir sa politique migratoire, face à la poussée de la droite et de l’extrême droite sur le continent. Après de premières mesures mi-mars, la Commission a dévoilé une liste de sept pays qu’elle considère comme « sûrs », ce qui signifie que leurs ressortissants n’ont a priori pas le profil de réfugiés-es. Cette liste comprend le Kosovo, le Bangladesh, la Colombie, l’Egypte, l’Inde, le Maroc et la Tunisie. L’objectif de cette liste est de permettre d’accélérer le traitement des demandes d’asile des personnes originaires de ces pays et de hâter éventuellement leur rapatriement. À cela s’ajoutent les pays candidats à une adhésion à l’UE, dont la Commission considère qu’ils remplissent, pour la plupart, « les critères pour être désignés comme pays d’origine sûrs ». Plusieurs États de l’UE appliquent déjà ce concept à l’échelle nationale, rappelle l’AFP. La France, par exemple, a une liste d’une dizaine de pays qu’elle considère comme sûrs, qui inclut la Mongolie, la Serbie ou le Cap-Vert. Tout comme la Belgique ou l’Allemagne. Mais il n’existe pas encore de liste commune et harmonisée à l’échelle européenne. La liste dévoilée mercredi 16 avril est « dynamique », et peut-être élargie ou restreinte en fonction de l’évolution des droits humains dans les pays qui y figurent, a précisé la Commission. Dans sa proposition d’une quarantaine de pages, la Commission évoque le cas de chaque pays, point par point. Et notamment celui de la Tunisie, accusée par l’ONU de « persécuter » ses opposants-es. L’exécutif européen considère que « les actes de répression [qui s’y déroulent, ndlr] n’atteignent pas un niveau qui permettrait de parler d’une situation de répression systématique à grande échelle », estime-t-elle. Pour entrer en vigueur, cette proposition devra être approuvée par le Parlement européen et les États membres. Elle s’appliquerait alors à tous les pays de l’UE. La Commission européenne avait déjà présenté une liste du même type en 2015. Mais ce projet avait finalement été abandonné, en raison de vifs débats sur l’idée d’inclure, ou non, la Turquie, avec son bilan mitigé en matière d’indépendance de la justice, de droits des minorités et de liberté de la presse.
François Hollande dépose une proposition de loi créant un statut de "réfugié scientifique"
Attirer en France les chercheurs-ses américains-es menacés-es par l’administration Trump ? C’est l’idée du député François Hollande qui vient de déposer sa première proposition de loi. Le texte a pour ambition de créer un statut spécifique de « réfugié scientifique ». Face au nombre croissant de scientifiques américains-es qui songent à quitter leur pays en raison des politiques menées par le président américain, « il faut ouvrir très rapidement un cadre juridique durable et simple » pour les accueillir, a expliqué l’ancien président de la République à l’AFP. L’objectif du texte est de « faciliter les procédures » en accordant aux scientifiques concernés-es « un statut qui serait un statut de réfugié », comme « il existe des réfugiés climatiques », détaille-t-il. « Au-delà du geste », il s’agit « de donner l’image (…) d’un pays qui accueille ces scientifiques », notamment dans les domaines les plus concernés par « les mesures » prises par Donald Trump : le climat et la santé. Il s’agit également pour la France de se positionner pour séduire les meilleurs talents. « Nous ne sommes pas les seuls à vouloir les attirer », explique François Hollande, citant la Chine « qui fait des efforts considérables pour faire revenir » de nombreux chercheurs sino-américains, mais également le Royaume-Uni ou l’Allemagne. De plus en plus de chercheurs-ses ou d’aspirants-es chercheurs-ses réfléchissent à quitter les États-Unis, considéré jusqu’ici comme le paradis de la recherche dans nombre de domaines. Selon un sondage publié fin mars par la revue spécialisée Nature, plus de 75 % songent aujourd’hui à un tel départ. En France, le ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Philippe Baptiste, a demandé, début mars, aux universités de réfléchir à des moyens de les accueillir. Plusieurs d’entre elles ont annoncé lancer de tels programmes pour aussi financer des travaux qui ne pourraient plus y être menés. Des initiatives similaires ont été prises ailleurs dans le monde.

Etats-Unis : Trump fait baisser les prix des médicaments
Esbrouffe ou stratégie ? Donald Trump a signé, mardi 15 avril, un décret dans lequel il ordonne à son gouvernement de travailler à une série de mesures pour faire baisser le prix des médicaments aux États-Unis ; les prix y sont significativement plus élevés qu'à l'étranger, note l’AFP. Parmi les actions listées : l'amélioration du processus de négociation entre l'assurance-santé publique et les groupes pharmaceutiques ou encore la possibilité offerte aux États d'importer directement des médicaments depuis des pays étrangers aux coûts moindres.
Selon une étude de la Rand Corporation (une société de conseil et de recherche américaine spécialisée dans l’analyse stratégique), les États-Unis payent en moyenne 2,5 fois plus pour les médicaments sur ordonnance que la France par exemple. Un écart que Donald Trump s'était engagé à réduire au cours de sa campagne présidentielle. « Rien n'assure pour autant que les mesures annoncées puissent se traduire par une baisse des prix pour les Américains-es, du moins dans l'immédiat », explique, de son côté, l’agence de presse APM. Elle rappelle que les négociations sont des « processus au long cours », d’autant qu’il existe différents systèmes (par exemple l'assurance-santé publique des plus de 65 ans dite « Medicare »). Par ailleurs, c’est en 2026 que doivent entrer en vigueur les tarifs réduits négociés sous l’administration Biden ; Donald Trump n’est pas le seul à vouloir que les prix des médicaments baissent. L’APM pointe aussi un paradoxe dans la stratégie de l’administration Trump. Elle envisage de lancer une « enquête sur la part des importations dans le secteur pharmaceutique », ce qui laisse supposer, vu la tendance actuelle, une éventuelle augmentation des droits de douane. « Or, une telle mesure augmenterait les coûts des nombreux médicaments et composés chimiques importés », note l’APM.
