L’Actu vue par Remaides : « Sérophobie et blouses blanches : les personnes vivant avec le VIH voient rouge ! »
- Actualité
- 31.03.2025

DR
Par Jean-François Laforgerie
Spécial Sérophobie
Sérophobie et blouses blanches : les personnes vivant avec le VIH voient rouge !
Malgré de grandes avancées médicales dans la lutte contre le VIH, la sérophobie reste une réalité bien ancrée, notamment dans le milieu médical. Des refus de soins discriminatoires aux comportements stigmatisants, les personnes vivant avec le VIH continuent de subir des injustices flagrantes, contraires à la déontologie et aux droits fondamentaux. Témoignages édifiants, enquêtes et décisions judiciaires marquantes éclairent une réalité souvent minorée et méconnue, qui attend une solution urgente, en France comme à l’international. La rédaction de Remaides fait le point.
Deux refus de soins sérophobes récemment sanctionnés en France
« En droit, une discrimination, c’est une inégalité de traitement dans un des domaines prévus par la loi que sont l’emploi et l’accès aux biens et aux services. Et dans l’accès aux biens et services, il y a justement l’accès aux soins », explique Claire Hédon. La Défenseure des droits (DDD) fait partie, ce 30 novembre dernier, des intervenants-es d’une table ronde consacrée aux discriminations et aux solutions pour en finir avec la sérophobie. Cette table ronde a été proposée à l’occasion du grand événement (organisé par AIDES, Libération et La Maison des Métallos, à Paris) pour les 40 ans de l’association. En fonction depuis 2020, la DDD a choisi de centrer son intervention sur « les refus de soins discriminatoires », notamment ceux liés au VIH, observés par l’institution qu’elle dirige. « Chaque année, nous sommes saisis de quelques dizaines de situations de refus de soins ou plus largement de traitements discriminatoires qui sont opposés à des personnes porteuses du VIH, note Claire Hédon. Évidemment, ce n’est pas du tout révélateur de l’ampleur des discriminations. J’ai parfaitement conscience du gouffre qui existe entre ce que nous pouvons voir dans une institution comme la nôtre et la réalité du terrain. ». Autrement dit, les données des services de la DDD ne signifient pas que le phénomène de la discrimination sérophobe en santé n’ait pas plus d’ampleur dans la vraie vie. « Je voudrais vous citer deux décisions récentes, dont nous sommes contents, explique Claire Hédon. Nous avons obtenu gain de cause dans les deux cas : une devant la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins, puis la justice ; l’autre devant les tribunaux. Dans ces deux cas, nous avions rendu ce qu’on appelle des observations. Dans les pouvoirs de l’institution, nous n’avons pas de pouvoirs de contrainte, mais nous avons de forts pouvoirs d’enquête ; ce dont nous nous sommes servis. » « Dans une affaire, nous avons accompagné le réclamant, dans la procédure devant l’Ordre, puis devant le tribunal pour montrer et prouver la discrimination. Au motif du « principe de précaution », une médecin avait refusé qu’une patiente vivant avec le VIH soit reçue dans sa clinique afin de bénéficier d’un soin esthétique. Dans ce cas, nous avons présenté nos observations devant la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins. Elles ont été suivies. La chambre estimant que ce « refus ne saurait être légitime », mais qu’il était bel et bien discriminatoire. La médecin a été condamnée, pour discrimination et pratique de la médecine comme un commerce, a une peine de six mois de suspension d’exercice, dont deux mois ferme et a payé 2000 euros d’amende », a indiqué la DDD. « Dans l’autre cas, une décision a été rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg, le 7 novembre 2024. Cette décision correspond également au sens de nos observations. Le tribunal a constaté un refus de soins discriminatoire qui avait été opposé par un centre de santé dentaire à une personne vivant avec le VIH. Dans cette situation, la dentiste avait dit qu’elle ne se sentait pas à l’aise sur le fait de traiter une personne porteuse du VIH/sida. Le tribunal a condamné le centre à indemniser le patient pour le préjudice moral résultant de cette dis crimination. Le dédommagement a été estimé à 1 000 euros », a-t-elle expliqué. Et Claire Hédon de conclure : « Bon, nous faisons la même conclusion : l’amende infligée n’est pas très élevée. Elle ne me paraît pas encore totalement dissuasive. Je pense qu’on pourrait aller plus loin, mais c’est déjà une belle avancée de reconnaissance. Ces décisions constituent deux avancées en ce qu’elles affirment que ces deux comportements sont contraires à la déontologie médicale. Et ça, c’est important de le rappeler. »
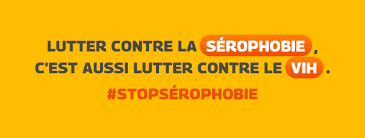
Un monde médical pour partie sérophobe ?
« Je pense que, par préférence, il vaut mieux pour vous que vous alliez à l’hôpital, comme ça, ils prendront plus de précautions. » « Vous serez mieux pris en charge à l’hôpital. Ils ont de meilleures conditions et de meilleures désinfections possibles pour les patients séropositifs. » « Il faudrait que vous vous organisiez pour venir un soir, pour la dernière consultation. ». Ces phrases, Libé les a publiées en 2015 ; Le Parisien aussi. Elles proviennent d’un testing fait par l’association AIDES auprès de dentistes en France. Il faut se méfier des représentations. On les suppose plus et mieux informés-es, davantage soucieux-ses et respectueux-ses de l’éthique. Pourtant, certains-es professionnels-les de santé ne sont malheureusement pas en reste en termes de mauvais comportements ou de traitements différentiels, voire de refus de soin. En 2015, AIDES réalise donc un testing auprès de 570 cabinets dentaires (20 % avec un contact direct avec le dentiste et 80 % avec un contact avec le secrétariat du-de la praticien-ne) dans vingt villes françaises. Chaque cabinet est appelé par deux personnes différentes sur la même période pour un détartrage : une fois, par une personne qui dit être séropositive au VIH ; une autre fois par une personne supposée séronégative au VIH. Ces deux personnes ayant un profil similaire hormis le statut sérologique. Les réponses des cabinets étaient ensuite comparées.
Le testing montre des discriminations évidentes à l’encontre des personnes séropositives :
- 33,6 % de refus de soins (directs ou déguisés) imputables au VIH ;
- 16,8 % de discriminations et de disparités de traitement en raison du statut sérologique.
Cette enquête de 2015 a révélé « l’existence de traitements différenciés entre les testeurs séropositifs au VIH et les testeurs ne déclarant pas leur sérologie au VIH, [mais] il est important de noter que de nombreux dentistes ou secrétaires ont donné des rendez-vous aux testeurs séropositifs au VIH sans évoquer aucun des motifs jugés discriminatoires », constatait alors l’équipe de recherche de AIDES. Elle soulignait que : « Pour 57,9 % des dentistes ou secrétaires, les pratiques de soin, l’accueil et la communication ont été conformes à la déontologie médicale. Certains ont aussi fait preuve de bienveillance avec une approche globale de la prise en charge médicale de la personne. » Il n’en demeure pas moins que le niveau de traitements différenciés du fait de la séropositivité, voire de refus de soins restait à un niveau élevé et en rupture avec le code de déontologie et les recommandations officielles de prise en charge. Ce n’était d’ailleurs pas la seule spécialité médicale dont les pratiques étaient interrogées. Un volet du testing de AIDES portait sur les gynécologues. Certains-es d’entre eux-elles ont pu être mis-es en cause dans des témoignages. En 2015, sur un échantillon plus modeste de cabinets, les résultats indiquaient « deux refus de soins directement liés au VIH, soit 1,7 % des prises de rendez-vous » lors du testing. Le taux montait cependant à 4,3% pour les refus déguisés. Dans une étude réalisée par SIS association en 2019, 67 % des répondants-es indiquaient s’être déjà sentis-es discrimininés-es depuis l’annonce de leur séropositivité. Près de trois répondants-es sur cinq l’ont été dans le milieu médical et paramédical.
Un phénomène d'actualité
À l’occasion de ses 40 ans, AIDES a confié à l’Ifop la réalisation d’une étude sur La sérophobie en France et les représentations du VIH 40 ans après sa découverte. Dans cette étude, réalisée en juin 2024 et publiée en septembre 2024, 78 % des Français-es considèrent que les personnes séropositives sont « victimes de discrimination aujourd’hui en France ; et 37 % pensent qu’elles sont victimes de discrimination « par les professionnels de santé aujourd’hui en France : « Oui, beaucoup » pour 8 % des répondants-es ; « Oui, un peu », pour 29 %. Celles et ceux qui partagent le plus cet avis se trouvent parmi les personnes âgées entre 18 et 49 ans. L’enquête souligne un paradoxe car, si plus d’un tiers des répondants-es reconnaissent l’existence de cette discrimination dans le soin, 14 % des répondants-es à l’Ifop expliquent « être mal à l’aise » à l’idée de fréquenter le même cabinet médical qu’une personne séropositive. » Cette même question avait été posée en novembre 2017, le niveau était alors de 10 %. En 2021, le CRIPS Île-de-France avait demandé à l’institut CSA d’étudier Le rapport des Français au VIH/sida, 40 ans après son apparition. Il s’agissait d’évaluer les connaissances en matière de VIH et d’analyser les perceptions ders Français-es en la matière. Y était exploré le « malaise » que pouvaient ressentir les Français-es dans différentes situations. La même hypothèse était présentée : 13 % des personnes disaient être mal à l’aise à l’idée de fréquenter le même cabinet médical qu’une personne séropositive. Le résultat était encore moins bon dans l’hypothèse où c’était le « médecin traitant » qui était séropositif. Dans ce cas, 21 % des répondants-es faisaient part de leur « malaise ». Le fait de « savoir précisément ce qu’est une personne séropositive » ne jouait que marginalement sur les idées reçues, puisque, dans ce cas, le chiffre fléchissait à 19 %. Il baissait à 18 % chez les personnes se déclarant « très bien informées au sujet du VIH/sida. » Les personnes de moins de 35 ans et les CSP – (catégories socio-professionnelles intermédiaires) étaient les personnes les « plus incommodées » par cette situation : 27 % chez les moins de 18 ans ; 23 % chez les moins de 35 ans ; 23 % chez les CSP –.
Un phénomène d'ampleur dans le monde
La sérophobie dans le soin n’est pas un phénomène récent, ni circonscrit à la France. Elle existe chez certains de nos proches voisins. En mars 2017, Charlotte Pezeril, docteure en anthropologie sociale et directrice scientifique de l’Observatoire du sida et des sexualités en Belgique, publie les résultats d’une vaste enquête dans La sérophobie en actes. Analyse des signalements pour discrimination liée au VIH/sida déposés chez Unia (2003-2014). Unia est l’équivalent de la Défenseure des droits en Belgique. Une partie du document est consacrée aux discriminations dans le soin. Il y est question de report ou de refus d’interventions ou d’opérations médicales concernant, entre autres, la cheville, l’appendicite et même un recollement d’oreille chez des personnes vivant avec le VIH ; mais ce sont surtout des interventions dentaires qui donnent lieu à des refus plus ou moins « déguisés ». « Dans ces derniers cas, le dentiste ne refuse pas explicitement le soin à cause du VIH, mais renvoie le patient vers un collègue estimé plus compétent », souligne le rapport. « La discrimination ne se dit pas comme telle, ce qui rend d’autant plus difficile sa condamnation », constate, avec amertume, le document. Comme c’est le cas en France, la question de « l’ordre de passage » se pose. Les patients-es déclarant leur séropositivité étant placés-es en dernier. Symptomatique, ce procédé a d’ailleurs fait l’objet d’une procédure juridique en Belgique, rap pelle Charlotte Pezeril.
« Suite à une plainte collective de 2013 de l’association The Warning-Bruxelles (groupe militant pour la santé gaie) quant à la pratique de dentistes exigeant des patients séropositifs qu’ils soient les derniers patients du jour sous peine de refus de soins, Unia a constitué un dossier bibliographique sur cette question. Les conclusions soulignent l’inanité de la mesure en rappelant d’une part l’efficacité et la nécessité de l’universalité des mesures de désinfection du matériel, d’autre part l’ignorance du statut sérologique de l’ensemble des patients et enfin, la nécessité de prendre en compte la fragilité des patients immunodépressifs. L’ordre de passage n’a donc aucun fondement scientifique et a pour seul effet de stigmatiser les PVVIH et de les décourager à révéler leur statut ou à recourir aux soins », souligne le document publié en 2017. Malheureusement d’autres pays que la Belgique sont concernés. Dans son rapport L’urgence d’aujourd’hui ; le sida à la croisée des chemins (2024), l’Onusida a compilé des données permettant de mesurer les niveaux de stigmatisation et de discrimination à l’encontre des PVVIH, dont ceux du milieu du soin. L’institution onusienne fait état de 13 % des personnes vivant avec le VIH ayant été victimes de discriminations dans le milieu de soins VIH, les douze derniers mois avant l’enquête. Cette proportion double dès lors qu’on prend en compte le soin hors secteur de prise en charge du VIH. Ainsi, « près d’un quart des personnes vivant avec le VIH ont déclaré avoir été victimes de stigmatisation lorsqu’elles ont cherché à obtenir des services de santé non liés au VIH au cours de l’année précédente », déplore l’étude. Ces résultats sont tirés d’une analyse de « l’indice de stigmatisation » réalisée à partir d’enquêtes menées dans 25 pays, parmi lesquels le Cameroun, le Sénégal, l’Ouganda, le Vietnam, le Pérou, la Bolivie, le Paraguay, le Belarus, la Moldavie, la Russie, l’Ukraine, le Kenya, l’Angola, le Bénin, etc. Ce phénomène qui perdure, alerte depuis des années l’Onusida. Dans un rapport de 2020, l’institution constatait déjà, parmi les pays disposant de données, jusqu’à 21 % des personnes vivant avec le VIH déclarant « s’être vu refuser des soins de santé au cours des 12 derniers mois ». Cette « sérophobie médicale » prend d’ailleurs des tours différents selon les pays. Dans onze d’entre eux (non cités par l’Onusida), 40 % des personnes vivant avec le VIH « déclarent avoir été contraintes de se soumettre à une procédure médicale de santé » ; par exemple, une obligation de dépistage. Dans le monde, jusqu’à 26 % des femmes vivant avec le VIH ont déclaré que le « traitement du VIH était conditionnel à la prise de contraceptifs ». Autrement dit une forme de chantage fait aux femmes : leur santé contre la maternité !
Une enquête sur la sérophobie révèle des discriminations alarmantes et des solutions possibles
En mars 2024, la Maison de vie (un lieu, unique en Europe, de ressourcement pour les personnes vivant avec le VIH) a publié une enquête sur Sérophobie et qualité de vie. Elle a été réalisée par l’Institut Stethos en partenariat avec la Dilcrah (délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT) et la firme pharmaceutique ViiV Healthcare. L’enquête était complexe puisqu’elle portait sur la perception des personnes vivant avec le VIH auprès d’un échantillon de Français-es représentatif de la population française, de focus groupes réunissant des personnes vivant avec le VIH, intégrant un week-end de personnes vivant avec le VIH âgées de moins de 35 ans, et d’une enquête par internet auprès de 150 personnes vivant avec le VIH. L’enquête abordait cinq situations de discrimination ayant été vécues dans le domaine de la santé. Sur l’ensemble des personnes vivant avec le VIH interrogées : 5 % mentionnaient des difficultés d’accès aux maisons de retraite ; 36 % indiquaient des refus de certains actes médicaux par le personnel médical lui-même ; 33 % des propositions d’horaires de rendez-vous médicaux inadéquats, 21 % l’exclusion de certains traitements ; 23 % des refus de rendez-vous médicaux. Des données qui confirment la permanence d’un niveau édifiant de discriminations. Bien sûr, ces chiffres, comme ceux d’autres enquêtes d’ailleurs, ne permettent pas complétement de montrer l’évolution des pratiques dans le temps. Il y a des différences notables de prise en charge en fonction de la date du diagnostic. L’exemple le plus édifiant est celui de la prise en charge de la grossesse des femmes vivant avec le VIH. Aujourd’hui, il semble plus simple d’attaquer un refus de soins sérophobe qu’auparavant. Il est possible de changer de médecin en cas de mauvaise expérience pour un médecin dit « VIH friendly ». Reste que cette « possibilité » a ses limites : l’augmentation de la désertification médicale dans de nombreuses régions et villes, le départ en retraite de toute une génération de médecins spécialisés-es dans le VIH, un changement de profil des praticiens-nes y compris dans l’infectiologie, etc. Ce n’est pas un hasard si dans l’enquête de la Maison de vie, le contexte actuel fait l’objet d’un « point d’inquiétude ». Et maintenant… que faire contre la sérophobie ? La question conclut l’enquête de la Maison de vie. Un triptyque d’actions semble se dessiner : « Communiquer, témoigner et former ». Former : un objectif évident dans le champ du soin. Et un participant d’un focus groupe de recommander : « Je voudrais une vraie formation pour tout le personnel soignant. Une formation avec une mise en pratique, une vraie formation. Que ce soit technique ou simplement sur les représentations et l’accueil d’une personne séropositive ».
