L'actu vue par REMAIDES : "Paris 2024 : le Revers de la Médaille au rapport"
- Actualité
- 12.06.2024
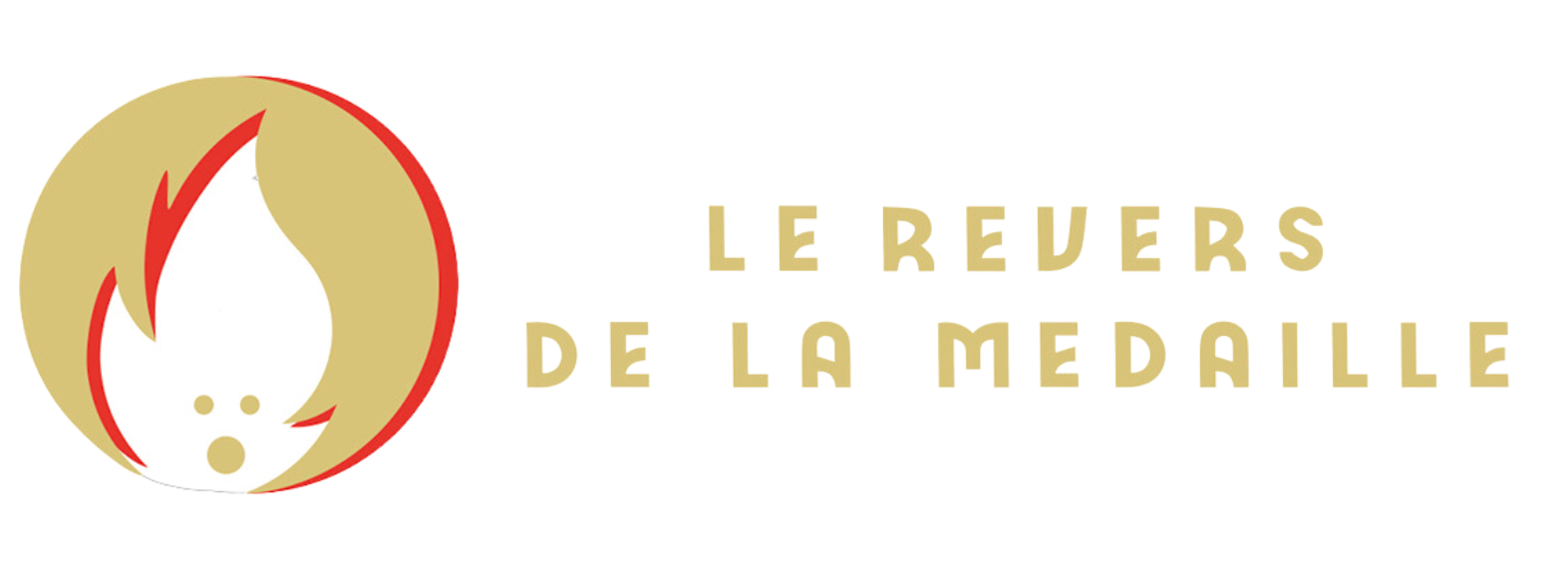
© DR
Par Jean-François Laforgerie et Fred Lebreton
Paris 2024 : le revers de la médaille au rapport
Dans le champ des discriminations, ce ne sont pas les infos qui manquent. En cette période, c’est la sortie du rapport réalisé par le Revers de la Médaille sur les conséquences sociales des Jeux Olympiques et Paralympiques paris 2024 qui a marqué les esprits. Autre initiative : la Pride Radicale revient pour une 3ème édition à Paris, le 16 juin. De son côté, l’Onusida a défendu son engagement aux côtés des communautés LGBTQ+ du monde entier à l’occasion de l’ouverture de la saison des Prides. Les nouvelles ne sont pas bonnes du côté de la sérophobie si on en juge par le résultat d’un récent sondage qui indique que la moitié des Britanniques sont mal à l'aise à l'idée d'embrasser une personne vivant avec le VIH. Au Pérou, une importante manifestation s’est déroulée contre un décret associant la transidentité à un trouble mental. La rédaction de Remaides fait le point sur l’actu dans le champ des discriminations.
Paris 2024 : le Revers de la Médaille au rapport
AIDES Île-de-France est mobilisés-e au sein du collectif Le Revers de la Médaille aux côtés d’autres associations. Ce collectif a été créé pour « alerter sur l’impact social et sanitaire » de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Sur son site, le collectif explique son double objectif : « Nous, associations, acteurs et actrices de la solidarité alertons sur l'impact social de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, et plaidons pour un héritage positif dans la lutte contre l'exclusion. Dans ce contexte, des militants-es de AIDES ont contribué, grâce à la documentation de différentes situations sur le terrain, au rapport produit par le collectif intitulé « Un an de nettoyage social ». Ce rapport de près de 80 pages a été présenté à la presse lundi 3 juin par Paul Rey-Fauvinet, volontaire et référent JOP pour AIDES Île-de-France et Léa Palozzi, chargée de projet Caarud. « Notre présence a permis de porter une parole sur la situation des consommateurs-rices de produits et des travailleurs-ses du sexe dans la période actuelle en Île-de-France, et l’impact du renforcement du harcèlement et de la répression policière sur les consommateurs-rices de produits psychoactifs elles-eux-mêmes, et par extension sur les conditions de travail et d’intervention des équipes du terrain », expliquent les deux militants-es.
Ce rapport a également été présenté (6 juin) lors d'une soirée publique à la Cité Fertile, à Pantin. Dans son rapport, le collectif revient sur la notion de « nettoyage social ». « Par « nettoyage social », nous entendons le fait d’harceler, d'expulser et d'invisibiliser les populations catégorisées par les pouvoirs publics comme indésirables des lieux où se tiendront les JOP, et plus globalement des villes hôtes, ainsi que cela s'est produit dans de nombreuses autres villes les ayant accueillis ces dernières décennies, sans pour autant leur proposer une mise à l’abri pérenne », explique le document. « Ce nettoyage repose sur un double mouvement de dispersion : disperser dans l’espace public pour éviter les installations d’habitats informels qui seraient trop visibles et éloigner de l'agglomération parisienne les personnes très précaires qui peuvent avoir une occupation quotidienne de l’espace public ou être hébergées dans des structures hôtelières. Alors que ces logiques d’action publique sont à l'œuvre depuis plusieurs années, plusieurs indicateurs nous laissent penser que les JOP agissent comme un accélérateur de ces dispersions et éloignements. De ce point de vue, ils représentent un effet d’opportunité pour accroître et renforcer les processus d’invisibilisation des plus précaires de la capitale et de sa région », indiquent les auteurs-rices du rapport.
« Dans la nuit du 25 au 26 janvier 2024, 3 462 personnes sans solution d’hébergement à Paris ont été décomptées dans le cadre de la 7e édition de la Nuit de la Solidarité. Cela marque un accroissement de 16 % par rapport à l’édition précédente du 26 janvier 20231. Tous-tes les acteurs-rices s’accordent cependant à dire que ce chiffre est nécessairement inférieur à la réalité, toutes les personnes à la rue n’ayant pu être rencontrées en l’espace d’une nuit de maraude. La répartition géographique des sans-abris rencontrés ce soir-là est concentrée dans le périmètre de Paris Centre et du 12e arrondissement (incluant le bois de Vincennes), soit des lieux centraux pour les JOP 2024, ainsi que dans le 19e arrondissement — ces trois zones rassemblent plus de la moitié des personnes sans-abri décomptées (46 %) », explique le rapport. « Durant la période 2023-2024, l’Observatoire des expulsions de lieux de vie informels a recensé 138 expulsions en Île-de-France, parmi lesquelles 64 expulsions de bidonvilles, 34 expulsions de regroupements de tentes (exclusivement sur Paris et Aubervilliers), 33 expulsions de squats, ainsi que sept expulsions de personnes voyageuses. À titre de comparaison, 121 expulsions avaient été recensées sur la période 2021-2022, et 122 en 2022-2023. Ces expulsions ont concerné 12 545 personnes, une augmentation de 38,5 % par rapport à la période 2021-20222. Parmi ces personnes, 3 434 étaient mineures, soit deux fois plus que l’an dernier, et presque trois fois plus qu’en 2021-20223 », avance le rapport. Il rappelle que « 3 000 places d'hôtel social ont été supprimées en 2023 en Île-de France, dont la moitié en Seine-Saint-Denis, tandis que seulement 300 places supplémentaires au 115 sont annoncées comme « héritage social » ».
La Pride radicale revient pour une 3ème édition à Paris
Après une année de pause, la Pride Radicale revient le 16 juin 2024 à Paris sous le mot d’ordre : « Pour l'autodétermination et la libération des identités et des peuples ».
Pourquoi une Pride Radicale ? Un communiqué de presse nous en donne la clef : « La Pride Radicale est un regroupement de collectifs, d’associations et de personnes bénévoles. Nous portons une Marche des Fiertés indépendante de l’Inter-LGBT par nous et pour nous, personnes racisées, loin des récupérations politiques et financières et de l’instrumentalisation de nos luttes ». En juin 2021 et 2022, ce sont au total près de 70 000 personnes qui se sont réunies lors des premières éditions des Pride Radicales à Paris pour porter les enjeux antiracistes, anticapitalistes et anti-impérialistes sans lesquels, il est impossible de faire valoir les droits de toutes les personnes LGBTQIA+.
Pour l’édition 2024, plusieurs revendications sont mises en avant. « Au vu du contexte politique et géopolitique actuel, nous avons cette année choisi de mettre en avant l'autodétermination et la libération des identités et des peuples », expliquent les organisateurs-rices. Et d’expliquer : « L'autodétermination, c’est le droit fondamental des peuples et des individus de décider librement de leur identité, de leur mode de vie, de leurs choix en matière de santé, d’éducation et de participation communautaire sans entraves ni ingérences extérieures. Cette notion est donc primordiale pour les luttes anti-impérialistes, qui soutiennent le droit des peuples à décider de leur statut et de celui de leur pays. Nous marcherons aussi pour les victimes du colonialisme et du néocolonialisme, du Congo à la Palestine en passant par la Kanaky [Nouvelle Calédonie, ndlr]. L'autodétermination concerne aussi tous·tes les membres de la communauté LGBTQIA+. Nous la revendiquons pour les personnes lesbiennes, gays, bi, et asexuelles, qui n’ont pas encore un accès effectif aux droits garantissant leur autonomie, leur liberté et leur sécurité. Pour les personnes trans et intersexes, qui n’ont toujours pas le droit de disposer de leur corps et d’affirmer leur identité sans contrôle de l’État et de ses institutions. Pour les personnes handicapées et malades, qui vivent dans des espaces et institutions ségréguées sans réelle équité ni liberté quant à leurs choix d’avenir. Pour les travailleurs-ses du sexe, qui exercent leur métier sous contrôle étatique et policier et sans aucune protection sociale, personnelle et professionnelle. Pour les personnes musulmanes, qui n’ont pas le droit de pratiquer leur religion sans ingérence de l’État. Pour les personnes racisées, dont les corps sont traqués et contrôlés notamment dans les quartiers populaires. Enfin, pour les personnes migrantes, qui ne bénéficient pas au même titre que tous-tes de la liberté de circulation et d’installation ». Et de conclure : « Nous réaffirmons donc notre capacité à être acteurs-rices de nos luttes en poursuivant les combats qui ont donné naissance aux marches des fiertés. Celles qui s’en prennent à l’ordre établi pour enfin mettre fin aux violences que subissent les minorités dans un monde globalisé et mortifère ». La Pride Radicale ira de République à Nation. Rendez-vous à 14 heures pour entendre les prises de paroles, puis départ de la Pride vers 15 heures.
Fiertés : l'Onusida aux côtés des communautés LGBTQ+ du monde entier
Engagement. « Les évènements organisés autour du mois des Fiertés sont une preuve du potentiel de l’inclusion », a déclaré la directrice exécutive de l’Onusida, Winnie Byanyima, dans un communiqué (29 mai). « La Marche des Fiertés a permis à l’humanité de faire un grand pas en avant dans la lutte pour protéger les droits humains des personnes LGBTQ+. Tant de victoires ont été remportées. Mais les progrès réalisés sont menacés. Aujourd’hui, l’humanité a plus que jamais besoin de l’esprit de la Marche des Fiertés : pour protéger la santé de chacune et chacun, nous devons protéger les droits de tout le monde », a-t-elle poursuivi.
Côté avancées, on notera que 123 pays ne pénalisent pas ou plus les relations entre personnes du même sexe. « Ils n’ont jamais été aussi nombreux à rejeter la criminalisation », souligne l’Onusida. Rien que depuis 2019, le Botswana, le Gabon, l’Angola, le Bhoutan, Antigua-et-Barbuda, la Barbade, Singapour, Saint-Christophe-et-Niévès, les îles Cook, l’île Maurice et la Dominique ont abrogé les lois qui criminalisaient les personnes LGBTQ+. Côté reculs, l’Onusida constate que « les droits humains de la communauté LGBTQ+ sont menacés par un réseau mondial coordonné et bien financé d’extrémistes qui les cible ». Et d’avancer : « Ces personnes dépensent des millions pour promouvoir la haine et la division sociale et proposent des lois de plus en plus draconiennes pour punir les personnes LGBTQ+. Les attaques contre les personnes LGBTQ+ violent les droits humains et portent atteinte à la santé publique ». « Alors que nous traversons une période dangereuse, nous avons besoin du courage et de la solidarité de la part de tous et toutes (…) Cette décennie représente un moment charnière, car nous sommes en mesure de mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique, mais le recul des droits humains entrave les progrès. À une époque où le soutien aux défenseuses et défenseurs des droits humains est vital et urgent, le soutien financier aux organisations de la société civile diminue à mesure que les pays donateurs réduisent leurs budgets. Pourtant, une chose est sûre : la stigmatisation tue, la solidarité sauve des vies. L’heure est à la solidarité. L’heure est à la FIERTÉ ».
Sérophobie : la moitié des Britaniques sont mal à l'aise à l'idée d'embrasser une personne vivant avec le VIH
Sérophobie. La moitié des adultes britanniques (50 %) seraient mal à l'aise à l'idée d'embrasser une personne vivant avec le VIH, selon un nouveau sondage sur les attitudes du public publié par l'association Terrence Higgins Trust. Ce sondage a été révélé à l’occasion de l'inauguration du jardin d'exposition célébrant les énormes progrès dans la lutte contre le VIH au RHS Chelsea Flower Show à Londres (Royaume-Uni). Le jardin Terrence Higgins Trust Bridge to 2030 Garden réutilise la pierre tombale emblématique, qui était la pièce maîtresse glaçante de la campagne de sensibilisation du gouvernement au plus fort de l’épidémie de VIH/sida en 1987, pour célébrer et faire connaitre les progrès réalisés dans la lutte contre le VIH depuis cette époque. « Il y a près de 40 ans, le message du gouvernement était « [le sida] est une maladie mortelle et il n'existe aucun remède connu ». Bien que cela fût vrai à l'époque, le concepteur de jardins primé Matthew Childs a réutilisé la pierre tombale comme un pont pour emmener les visiteurs du salon dans un voyage, depuis la peur des années 1980 jusqu'à aujourd'hui, où l'on peut vivre une vie longue et en bonne santé avec le VIH », souligne le Terrence Higgins Trust.
Malheureusement certaines représentations ont la peau dure et un nouveau sondage montre bien le décalage entre les avancées thérapeutiques et les peurs irrationnelles liées au VIH. Ce nouveau sondage, réalisé par YouGov auprès de 2 267 Britanniques, révèle que quatre Britanniques sur dix (41 %) seraient mal à l'aise à l'idée de sortir avec une personne vivant avec le VIH. De plus, seulement 16 % des répondants-es se sentent à l'aise d'avoir des rapports sexuels avec une personne vivant avec le VIH qui suit un traitement efficace. Autre donnée inquiétante, moins d'un quart des adultes britanniques (23 %) connaissent la notion Indétectable = Intransmissible, un fait scientifique connu depuis 2008 et entériné par l’étude Partner depuis 2014. Un peu plus réjouissant, le sondage montre que 61 % des Britanniques savent qu'une personne vivant avec le VIH sous traitement peut avoir la même espérance de vie qu’une personne séronégative en bonne santé, tandis que 38 % sont conscients-es que les femmes vivant avec le VIH peuvent avoir des bébés séronégatifs.
LEIA est là : un dispositif d'aide à distance pour les questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre
À l’occasion du 17 mai, Journée internationale de lutte contre les LGBTQIphobies, SIS Association annonce le lancement de LÉIA est là : un dispositif d’aide à distance pour les questions d’orientation sexuelle et d’identité de genre. Le dispositif s’adresse à toute personne qui se questionne sur son orientation sexuelle et/ou son identité de genre, mais aussi à leur entourage et aux professionnels-les qui souhaitent les aider/accompagner.
« En explorant le vécu de l’individu, mais aussi les origines de son questionnement, en abordant les stéréotypes et les préjugés expérimentés, les professionnels de l’écoute de LÉIA est là apportent un éclairage pertinent sur le sujet. En abordant des sujets sensibles avec clarté et engagement, ce dispositif propose un réel soutien psychologique et moral. Il permet aux individus d’être eux-mêmes, et de trouver un espace de dialogue sans jugement », promet l’association dans un communiqué. « À l'occasion de ce lancement significatif, nous affirmons notre engagement continu envers la communauté LGBTQIA+. LÉIA est là est plus qu'une ligne d'écoute ; c'est un espace sûr où chaque individu peut s'exprimer librement et chercher de l'aide sans jugement. Cette initiative reflète notre détermination à combattre l'isolement et à promouvoir l'acceptation universelle. Ensemble, avançons vers une société où la tolérance et l'empathie prédominent », commente Arame Mbodje, directrice de SIS association.
Pérou : manifestation contre un décret associant la transidentité à un trouble mental
Régression. Plus de 200 membres de groupes LGBT+ ont manifesté vendredi 17 mai devant le ministère péruvien de la Santé à Lima après que le gouvernement a publié un décret classant la transidentité parmi les « troubles mentaux ». « C’est un décret qui nous ramène trois décennies en arrière », a déploré Jorge Apolaya, porte-parole du collectif de la Marche des Fiertés de Lima. « Nous ne pouvons pas vivre dans un pays où nous sommes considérés-es comme des malades », met-il en avant.
Dans un décret publié le 10 mai, le ministère de la Santé a mis à jour une liste des prestations minimales auxquelles une personne assurée a droit en y incluant les services destinés aux personnes transgenres. Depuis 2021, cette liste intègre les maladies mentales. Mais, en voulant étendre sa liste aux traitements liés à l’identité de genre, incluant les thérapies de réaffirmation ou les opérations de réassignation sexuelle, le gouvernement a utilisé une classification obsolète de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), décrivant la transidentité comme un « trouble mental ». L’OMS a retiré cette terminologie de son manuel révisé des diagnostics en 2022. « Nous demandons l’abrogation de ce décret transphobe et violent, qui va à l’encontre de nos identités de personnes trans au Pérou », a déclaré à l’AFP Gianna Camacho, porte-parole de la Coordination nationale LGTBIQ+. « Nous ne sommes pas des malades mentaux et nous ne souffrons d’aucun trouble mental », a-t-elle ajouté. Le gouvernement a déclaré vendredi qu’il n’abrogerait pas le décret. « Le décret restera en vigueur parce que nous ne pouvons pas supprimer le droit aux soins », a expliqué à l’AFP Carlos Alvarado, un responsable du ministère. Le ministère a précédemment insisté sur le fait qu’il ne considérait pas la diversité sexuelle comme une maladie et a exprimé dans un communiqué « notre respect pour les identités sexuelles et notre rejet de la stigmatisation de la diversité sexuelle ». Il précise que le décret vise simplement à étendre la prise en charge de la santé mentale « pour le plein exercice du droit à la santé et au bien-être » des personnes qui le souhaitent ou qui en ont besoin.
Cartes de presse : un collectif demande des changements
Six associations ont demandé vendredi 31 mai un changement des règles de la carte de presse afin d’autoriser d’une part le port du voile sur sa photo d’identité, à la suite d’un litige avec une journaliste musulmane. Le collectif d’associations voit aussi une autre « discrimination » touchant les journalistes transgenres n’ayant pas effectué leur changement d’état civil et contraints-es d’inscrire leur « deadname » (ancien prénom et pronoms assignés à la naissance) sur leur carte de presse, explique l’AFP. De son côté, la Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels (CCIJP) a déploré dans un communiqué des « accusations erronées, non vérifiées et diffamantes », assurant qu’« aucune carte n’a jamais été refusée sur un motif autre que professionnel ». « Il faut que la CCIJP se déleste d’un règlement excluant de façon inutile », a plaidé, lors d’une conférence de presse, Arno Pedram, coprésident de l’Association des journalistes antiracistes et racisés-es (Ajar). « La carte de presse n’est pas un document d’identité, c’est une carte professionnelle. Libre à nous de la rendre à notre image ou de prétendre encore que le journalisme est restreint à une petite élite monochromatique », a-t-il appuyé, entouré d’autres associations (AJL, Prenons La Une, Femmes Journalistes de sport, Profession : Pigiste, La Chance).
Dans le cas de la journaliste portant le voile, l’AFP rappelle que Manal Fkihi a obtenu en 2021 sa première carte de presse avec une photo où elle était voilée. Puis le règlement de la CCIJP a changé, exigeant le respect des normes relatives aux photos des pièces nationales d’identité. Elle n’a pas eu de réponse favorable à ses nouvelles demandes et a préparé un recours. L’avocat Slim Ben Achour, qui l’assiste, a dénoncé une « discrimination ». « Si la CCIJP est une instance totalement indépendante, (sa) mission lui a été confiée par l’État », se défend la commission mise en cause. Il est donc « légitime » qu’elle « fasse siens les critères exigés par l’État pour ses documents officiels » et qui répondent « le mieux au besoin de sécurité ».
Dans le cas des journalistes transgenres n’ayant pas effectué leur changement d’état civil et contraints d’inscrire leur « deadname » (ancien nom) sur leur carte de presse, le collectif d’associations estime qu’il s’agit aussi d’une discrimination. « La carte n’est alors plus un outil de protection mais un risque » de dévoilement de la transidentité, ce qui peut exposer à des « insultes, agressions et violences », a affirmé Coline Folliot, coprésidente de l’Association des journalistes LGBT+ (AJL). La CCIJP rappelle laisser la possibilité aux journalistes « de faire figurer au recto de leur carte » leur nom d’usage ou leur pseudonyme, l’inscription de l’État civil au verso garantissant notamment la « crédibilité de cet outil de travail ».
Dans une tribune publiée par le Club de Mediapart, les six associations soutiennent que « ces discriminations racistes, sexistes, transphobes et islamophobes sont inacceptables et doivent cesser ». La CCIJP, qui regrette de « n’avoir été contactée par aucune » d’elles, fait valoir que ses membres sont « attentifs aux évolutions » de la société et qu’elle « reste ouverte » au dialogue. La carte de presse, renouvelée tous les ans auprès de cette instance, est un outil important pour les journalistes, facilitant les accès à de nombreux événements. Elle permet aussi le calcul d’une prime d’ancienneté. Elle n’est cependant pas obligatoire. La CCIJP est composée de représentants-es des éditeurs-rices de journaux et de syndicalistes élus-es par les journalistes.
