L’Actu vue par Remaides : IAS 2025 : « Sans les communautés, pas de fin du sida ! »
- Actualité
- 15.07.2025

Le centre des congrès de Kigali (Rwanda) qui accueille la conférence IAS 2025.
Photo : DR.
Par Fred Lebreton
IAS 2025 : "Sans les communautés,
pas de fin du sida !"
Du 14 au 17 juillet 2025, Kigali, capitale du Rwanda, devient le centre mondial de la science sur le VIH, en accueillant la conférence IAS 2025, la 13ᵉ édition de l’IAS. Cette conférence se concentre exclusivement sur les dernières avancées scientifiques et cliniques dans la lutte contre le VIH. La rédaction de Remaides vous propose une sélection des temps forts et des infos clefs. Retour sur la plénière d’ouverture qui a eu lieu lundi 14 juillet.
Entre Kigali et Paris sur le front des découvertes scientifiques VIH
Cette semaine, Kigali, la « ville aux mille collines », bruisse d’experts-es, de militants-es et de chercheurs-ses venus-es du monde entier pour la conférence de l’IAS sur le VIH. À 6000 kilomètres de là, nous suivons, depuis Paris et en visio, le fil des sessions et des découvertes scientifiques qui pourraient changer la donne dans la lutte contre le VIH, tout en maintenant le lien direct avec la conférence grâce à notre collègue Bruno Spire, administrateur et président d’honneur de AIDES, présent sur place pour capter les nuances que les écrans ne montrent pas. Car Kigali n’est pas qu’un décor : derrière ses collines verdoyantes, la capitale rwandaise porte aussi les mémoires, les espoirs et les tensions d’un pays en reconstruction, dans lequel la lutte contre le VIH se vit au quotidien.
« Recentrer, réaffirmer, reconstruire » la réponse mondiale au VIH

La Pre Beatriz Grinsztejn, infectiologue brésilienne de renom
et co-présidente de la conférence IAS 2025. Photo : Fred Lebreton
Lundi 14 juillet, il est 17h à Paris et à Kigali (pas de décalage horaire), le centre de conférence est plein, la plénière d’ouverture va commencer. Première intervenante, Beatriz Grinsztejn a donné le ton dès l’ouverture. Infectiologue brésilienne de renom et co-présidente de l’IAS 2025, elle a dressé un constat lucide des menaces qui pèsent aujourd’hui sur la réponse mondiale au VIH, tout en appelant à une mobilisation renouvelée. « C’est un privilège de vous accueillir à Kigali – une ville qui nous rappelle la résilience des communautés et le pouvoir de la reconstruction par la solidarité et la détermination », a-t-elle lancé en ouverture. Face aux reculs politiques, à la fragilisation des institutions scientifiques et à l’essoufflement de certains soutiens internationaux, la chercheuse de la Fondation Oswaldo Cruz à Rio de Janeiro (Brésil) a rappelé les fondamentaux : « La science reste la colonne vertébrale de notre réponse. Nous devons rester fermement attachés à notre solidarité collective. Nous devons dire la vérité au pouvoir. » Elle a salué les progrès portés par la recherche ― ARV, Prep, TPE, I = I ― tout en défendant l’indépendance des institutions de santé, « seule garantie de solutions fondées sur des preuves ». Beatriz Grinsztejn a également évoqué la fermeture de l’agence américaine USAID, saluant « la contribution inestimable » de ses experts-es, tout en soulignant les dangers d’un affaiblissement des partenariats historiques. « Nous avons perdu des milliers d’experts engagés dans le développement de la santé », a-t-elle regretté. Enfin, elle a appelé à une appropriation plus forte de la réponse à l’échelle nationale, et à un engagement collectif renouvelé. « Profitons pleinement de ce temps passé ensemble : pour réaffirmer, recentrer, reconstruire », a-t-elle conclu, traçant une voie à suivre pour les quatre jours de la conférence.
« Nous nous retrouvons à un moment charnière de la riposte mondiale au VIH »

La Pre Jeanine Condo, épidémiologiste rwandaise,
professeure à l’Université du Rwanda
et co-présidente de la conférence IAS 2025. Photo : Fred Lebreton
Jeanine Condo, épidémiologiste rwandaise, professeure à l’Université du Rwanda et co-présidente de la conférence IAS 2025, a salué un moment « puissant » : « Être rassemblés ici, à Kigali, au cœur de l’Afrique, unis par la science, la solidarité et la détermination commune à mettre fin au VIH comme menace pour la santé publique. » Sa prise de parole a incarné une volonté claire : remettre le continent africain au centre de la riposte mondiale au VIH. « Nous nous retrouvons à un moment charnière de la riposte mondiale au VIH ― une période marquée à la fois par la crise et par les opportunités », a-t-elle souligné. Pour la professeure Condo, le choix du Rwanda comme pays hôte ne relève pas d’un simple symbole, mais d’un « acte essentiel et fondamental pour le continent africain ». En insistant sur le rôle pivot de l’Afrique dans l’avenir de la recherche et des politiques de santé, elle a appelé à reconnaître « le leadership, la résilience et l’excellence scientifique » qui animent les acteurs-rices africains-es depuis plusieurs décennies. Jeanine Condo a également invité l’ensemble des parties prenantes à dépasser les discours et à bâtir ensemble des solutions concrètes : « Que l’IAS 2025 soit le moment où scientifiques, décideurs politiques, communautés et militants se réunissent, avec un leadership africain au centre, pour tracer ensemble la voie à suivre. Ensemble, nous sommes plus forts, et ensemble, nous relèverons les défis. »
« Tourner la page de la dépendance à l’aide internationale, pour aller vers une autonomie durable »
Depuis Genève, dans un message vidéo diffusé lors de cette plénière d’ouverture, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a lancé un appel pressant à la communauté internationale pour préserver les acquis de la lutte contre le VIH, aujourd’hui fragilisés. « Le retrait soudain des financements destinés aux programmes VIH provoque d’immenses perturbations dans l’accès aux services vitaux dans de nombreux pays », a-t-il alerté, rappelant que « depuis plus de deux décennies, des investissements constants ont permis des avancées majeures… Nous ne pouvons pas laisser ces progrès s’envoler. » Face aux menaces de désengagement international, Tedros Adhanom Ghebreyesus a plaidé pour une réponse concertée, mobilisant tous les acteurs-rices de la réponse au VIH : gouvernements, scientifiques, société civile et communautés concernées. « Ils doivent faire front commun pour préserver ces acquis et tracer une nouvelle voie durable, fondée sur la responsabilité partagée et l’équité », a-t-il insisté. Le chef de l’OMS, également ancien ministre de la Santé éthiopien, a souligné le fait que « nous avons les outils pour changer la donne dans la lutte contre le VIH ». Loin de se contenter d’un constat alarmiste, Tedros Adhanom Ghebreyesus a invité à transformer cette période de tensions en levier d’action. « Toute crise recèle une opportunité », a-t-il déclaré, avant de rapporter les propos de plusieurs ministres de la Santé et dirigeants-es ayant partagé avec lui leur volonté de « tourner la page de la dépendance à l’aide internationale, pour aller vers une autonomie durable en mobilisant des ressources nationales ».
« La résilience, mes amis, mérite le respect »

Rosemary W. Mburu, directrice exécutive de WACI Health,
militante historique de la réponse au VIH en Afrique. Photo : Fred Lebreton
Depuis la tribune de la plénière d’ouverture, la voix de Rosemary W. Mburu a résonné avec force et émotion. La directrice exécutive de WACI Health, militante historique de la réponse au VIH en Afrique, a livré un plaidoyer vibrant en faveur de l’action communautaire, qu’elle a décrite comme la véritable colonne vertébrale de la lutte contre les pandémies. « C’est un honneur de me tenir devant vous ici, dans cette ville remarquable au cœur de l’Afrique », a-t-elle déclaré en ouverture. Mais l’heure n’était pas aux cérémonies. Le ton grave, elle a souligné que le thème de son intervention ― soutenir l’action communautaire dans un environnement imprévisible et mouvant ― n’avait jamais été aussi crucial. L’activiste a rappelé que bien avant l’arrivée des grands bailleurs, des traitements salvateurs ou des conférences internationales, ce sont les communautés qui ont porté à bout de bras la réponse au VIH. « Au commencement, il y avait la communauté ― au cœur de tout ― bien avant les partenariats mondiaux, les médicaments miracles et les gros financements », a-t-elle lancé. « De San Francisco à Kigali, en passant par Delhi ou São Paulo, ces citoyens engagés ont dénoncé l’inaction des États, les logiques marchandes des laboratoires pharmaceutiques, et sont devenus des scientifiques citoyens – parce que nous n’avions pas le choix ». Face aux multiples crises qui menacent aujourd’hui ces dynamiques ― répression politique, financements instables, rétrécissement des espaces d’expression ― Rosemary W. Mburu a exhorté les acteurs mondiaux de la lutte contre le VIH à replacer les communautés au centre des politiques de santé. « La résilience, mes amis, mérite le respect », a-t-elle martelé, appelant à des financements « directs, flexibles et pérennes », à des cadres juridiques protecteurs et à une reconnaissance réelle du leadership communautaire. Pour la militante, la science sans humanité perd de sa portée : « La science, ce n’est pas seulement des données ! C’est de la dignité. » Elle a ainsi plaidé pour un changement de paradigme, où l’investissement dans les personnes ne serait plus perçu comme une option secondaire mais comme la condition sine qua non d’une réponse efficace et durable. « La résilience doit aller de pair avec le respect », a-t-elle insisté. Et la militante conclure, dans un cri fédérateur repris par la salle : « Vive les communautés ! »
« Si l’un d’entre nous meurt du sida, nous vous en tiendrons responsables ! »

Yvette Raphael, militante séropositive sud-africaine, fondatrice de l’organisation Pozie et figure de proue des luttes féministes et communautaires.
Photo : Fred Lebreton
Dans une atmosphère électrique et alors que le ministre rwandais de la Santé s’apprêtait à prendre la parole, des activistes rwandais-es séropositifs-ves, LGBT et travailleurs-ses du sexe sont montés-es sur scène.

Des activistes de la lutte contre le VIH envahissent la scène lors de l'ouverture de la conférence IAS 2025. Photo : Bruno Spire
Brandissant des pancartes avec des messages forts, les manifestants-es ont crié leur exaspération et leur volonté farouche de ne plus être effacés-es du combat mondial contre le VIH : « Nous ne disparaîtrons pas ! », ont lancé les activistes, repris à l’unisson par la salle. Yvette Raphael, militante séropositive sud-africaine, fondatrice de l’organisation Pozie et figure de proue des luttes féministes et communautaires, a pris la parole pour dénoncer l’hypocrisie des stratégies institutionnelles qui prétendent inclure les communautés tout en les marginalisant. « Le chemin vers la fin de la pandémie ne se construit pas à coups de notes de politique publique, de publications scientifiques ou de plans d’approvisionnement. Il repose sur les épaules des communautés, et il doit être dirigé par les communautés… C’est l’action communautaire qui donne une âme à la science. » Un rappel cinglant à l’ordre, salué par la salle.

Michael Igoboro, représentant de l’organisation Global Black Gay Men Connect. Photo : Fred Lebreton
Dans le même souffle indigné, Michael Igoboro, représentant de l’organisation Global Black Gay Men Connect, a enfoncé le clou. S’adressant directement aux responsables présents-es, il a interpellé : « Allez-vous prolonger votre apartheid ? L’intégration ne signifie rien ― cela veut juste dire que nous sommes relégués dans des systèmes de santé surchargés… » Avant d’asséner : « Nous vous avons vus ! Exclure les personnes trans ici… nous vendre pour obtenir des financements. Si l’un d’entre nous meurt du sida, nous vous en tiendrons responsables ! Nous ne disparaîtrons pas ! » a-t-il lancé, les yeux rivés vers le parterre d’officiels-les.
Rwanda : un exemple de riposte centrée sur les personnes
Sans transition, le Dr Sabin Nsanzimana, ministre de la Santé du Rwanda, a finalement pris la parole en esquissant les contours d’une riposte nationale au VIH qui force le respect. Épidémiologiste de formation, fin connaisseur des dynamiques sanitaires africaines et ancien directeur du Rwanda Biomedical Centre, il a souligné combien son pays avait su faire de la lutte contre le VIH un levier d’innovation et de transformation du système de santé. « L’expérience du Rwanda en matière de riposte au VIH au cours des dernières décennies ― ainsi que notre réponse récente à la pandémie ― démontre ce qui est possible lorsque les pays donnent la priorité aux approches centrées sur les personnes et investissent dans des partenariats stratégiques », a-t-il déclaré. En avance sur les objectifs 95-95-95 de l’Onusida, le Rwanda a su conjuguer ambition politique et pragmatisme sanitaire. À ce jour, 95 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut, 95 % de celles-ci sont sous traitement antirétroviral, et 95 % de celles sous traitement présentent une charge virale indétectable. Le Dr Nsanzimana a insisté sur l’importance des innovations thérapeutiques, notamment les traitements à action prolongée, déjà intégrés aux protocoles de soins dans le pays : « Nous continuons à exploiter les avancées scientifiques de pointe ― y compris les traitements à action prolongée ― pour proposer des interventions plus ciblées et intégrées. » Pour le ministre, l’heure n’est pas seulement à la célébration des progrès, mais aussi à la consolidation des acquis et à l’élargissement de l’accès aux innovations. « En regardant vers l’avenir, notre responsabilité partagée est de faire en sorte que ces innovations ne soient pas seulement développées, mais aussi accessibles équitablement à toutes celles et tous ceux qui en ont besoin », a-t-il martelé, appelant la communauté internationale à une solidarité accrue.
« Nous n’atteindrons pas 2030, ni au-delà, sans les communautés »
Last but not least, la Sud‑Africaine Linda‑Gail Bekker (LGB pour les intimes !), directrice du Desmond Tutu HIV Centre et figure de référence mondiale dans la lutte contre le VIH, a conclu cette plénière avec force et conviction. LGB a rappelé que l’Afrique restait l’épicentre de l’épidémie. « Aucun continent n’a été plus durement touché que le nôtre, ici. Sur les 40 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde, 26 millions vivent en Afrique », a-t-elle souligné d’emblée, posant le décor d’une réalité toujours brûlante, malgré les avancées thérapeutiques. La chercheuse et ancienne présidente de l’IAS, a salué les progrès réalisés en matière de prévention personnalisée. « Nous pouvons désormais personnaliser la prévention primaire du VIH en fonction des besoins et du mode de vie de chacun », a-t-elle déclaré, avant de souligner la diversité croissante des outils disponibles : « Nous disposons d’un éventail croissant d’options de prophylaxie pré-exposition et post-exposition. » Pourtant, ces promesses scientifiques se heurtent à un mur bien connu : celui de l’accès réel, de l’implémentation effective, et de l’inertie politique. Car les constats restent amers : « De manière générale, nous avons manqué tous les objectifs en matière de prévention primaire, avec un déploiement désespérément médiocre de la Prep orale… » En 2024, a-t-elle rappelé, « nos défis persistants restaient la stigmatisation et la discrimination, profondément enracinées ». Des freins sociaux qui continuent d’entraver la réponse à l’épidémie, en particulier dans les communautés les plus marginalisées. Linda‑Gail Bekker n’a pas hésité à détourner un slogan emblématique du trumpisme : « Ce qui a vraiment contribué à rendre l’Amérique grande (« Make America great again »), ce sont les 92 millions de vies sauvées grâce aux programmes de l’USAID sur une période de 22 ans. » Une manière habile de rappeler l’impact colossal de la coopération internationale, à condition qu’elle soit bien orientée et maintenue. Mais selon elle, aucun succès durable n’est possible sans les premières personnes concernées. « Nous n’atteindrons pas 2030, ni au-delà, sans les communautés », a-t-elle insisté. Et LGB de conclure : « Elles doivent être visibles, elles doivent être impliquées, elles doivent disposer des ressources nécessaires. »
MK-8527 : une Prep en comprimé une fois par mois ?
Présentée en conférence de presse plus tôt dans la journée, la nouvelle molécule MK-8527 pourrait bien bousculer les standards actuels de LA (Long Acting) Prep. Développé par le laboratoire Merck/MSD, ce comprimé oral à prendre une fois par mois inaugure une approche inédite dans le champ de la Prep à longue durée d’action. La Dre Rebeca Plank, scientifique au sein du département Global Clinical Development de Merck, a donné les premiers résultats d’un essai de phase 2 : « Les résultats montrent un profil de sécurité et de tolérance favorable, avec des données pharmacocinétiques soutenant une administration orale mensuelle dans nos études de phase 3 ». Autrement dit, la pilule mensuelle fonctionne, semble bien tolérée et va bientôt entrer dans une phase d’évaluation clinique plus large. La molécule MK-8527 appartient à la classe des inhibiteurs nucléosidiques de la translocation de la transcriptase inverse (NRTTI). L’étude de phase 2 a testé des doses allant jusqu’à 12 milligrammes pendant six mois. Résultat ? « Une sécurité et une tolérabilité similaires à celles du placebo », précise la chercheuse. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés — nausées et maux de tête — étaient répartis de façon similaire entre les personnes prenant le placebo et celles recevant le médicament, quel que soit le dosage. « Même à la dose de 12 milligrammes pendant six mois, le taux de lymphocytes restait comparable à celui du placebo », a insisté la Dre Plank. Cette précision est importante après ce qui s’est passé en 2021 avec islatravir, la molécule phare du laboratoire, qui avait connu une mise à l’arrêt brutale en raison d’une baisse anormale des lymphocytes. Les essais cliniques sur islatravir ont pu reprendre par la suite avec des doses plus faibles.
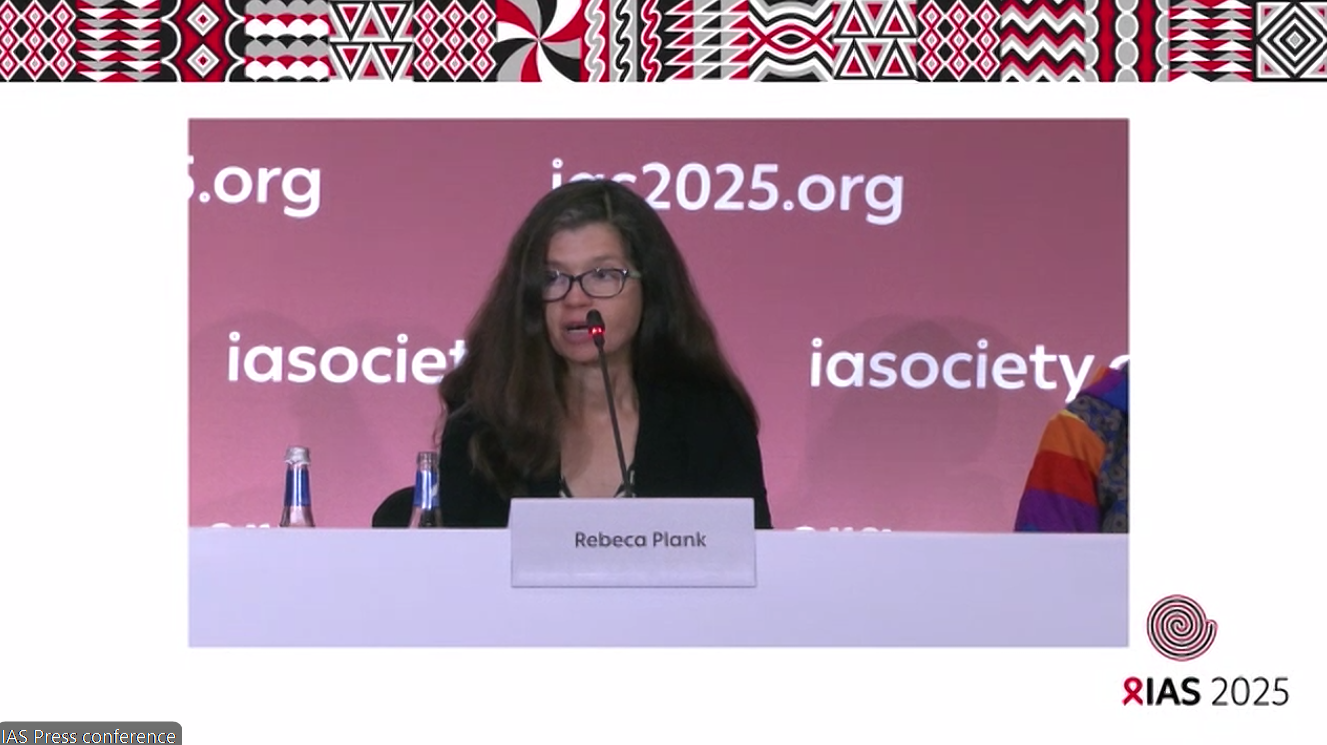
La Dre Rebeca Plank, scientifique au sein du département
Global Clinical Development du laboratoire pharmaceutique Merck.
Photo : Fred Lebreton
Merck/MSD avance ici une option sans injection, plus simple à stocker, à administrer et potentiellement plus acceptable pour certaines populations. « L’alternative orale mensuelle du 8527 pourrait représenter un changement de paradigme », a déclaré la Dre Plank. « Nous espérons que cette option offrira une solution à la fois facile à utiliser et compatible avec les systèmes de santé, pouvant être largement disponible dans différents contextes ». Deux vastes essais cliniques de phase 3, baptisés EXPrESSIVE, sont sur le point d’être lancés à l’automne, en partenariat avec la Fondation Gates et le Centre international de recherche clinique de l’Université de Washington. Leur objectif : évaluer l’efficacité préventive du MK-8527 auprès des populations les plus exposées au VIH. Merck/MSD affirme vouloir avancer à un rythme rapide : « Nous suivons des calendriers très ambitieux et optimistes », conclut la Dre Plank, qui appelle à la patience…
L'OMS recommande le lénacapavir en Prep injectable
Dans un communiqué publié le 14 juillet à l’occasion du lancement de la conférence IAS 2025, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé, pour la première fois, l’usage du lénacapavir injectable (LEN) deux fois par an comme nouvelle option de Prep contre le VIH. Présentée comme une percée décisive, cette stratégie pourrait transformer la prévention mondiale du virus, à un moment où les progrès stagnent avec encore 1,3 million de nouvelles infections en 2024. Le LEN devient ainsi la première Prep injectable semestrielle recommandée par l’OMS, en alternative aux pilules orales quotidiennes ou à d’autres options à durée d’action plus courte. Cette innovation répond aux besoins de nombreuses personnes confrontées à des obstacles d’adhésion quotidienne, à la stigmatisation ou à l’éloignement des soins, en particulier parmi les populations les plus exposées : travailleurs-ses du sexe, hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, personnes transgenres, usagers-ères de drogues injectables, personnes incarcérées, enfants et adolescents. « En l’absence d’un vaccin contre le VIH, le lenacapavir est ce qui s’en rapproche le plus », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, saluant un antirétroviral « à action prolongée qui a montré lors des essais qu’il prévenait presque toutes les infections à VIH chez les personnes les plus exposées à un risque de contracter le VIH ». L’OMS insiste sur l’urgence de déployer cet outil « immédiatement » au sein des programmes nationaux de prévention combinée, tout en appelant les gouvernements et bailleurs à faciliter son accès hors des essais cliniques. Reste donc à résoudre la question épineuse de l'accès et du coût de cette innovation thérapeutique vendue à un prix exorbitant (28 218 dollars par an aux États-Unis).
Remerciements à Franck Barbier, responsable pôle Parcours et Programmes nationaux ; Offres et dispositifs
