L’Actu vue par Remaides : « Chemsex, produits, pratiques et conséquences à Lyon, Marseille, Paris et Bordeaux »
- Actualité
- 13.11.2025
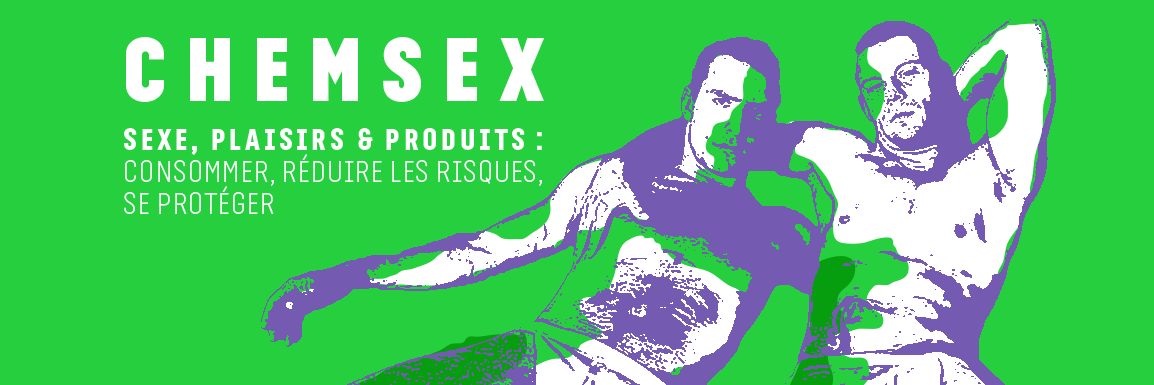
Visuel d'une campagne de AIDES sur le chemsex/Crédit Photo : AIDES
Par Jean-François Laforgerie
Chemsex, produits, pratiques et conséquences à Lyon, Marseille,
Paris et Bordeaux
Phénomènes émergents, évolutions en matière de trafic, de consommation, d’usages… tout cela est suivi par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT). Ce dernier publie régulièrement les rapports réalisés par les neuf coordinations régionales du dispositif Tendances récentes et nouvelles drogues (TREND). Ces rapports concernent des régions aussi différentes que : Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Auvergne Rhône-Alpes, Grand-Est, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Île-de-France, les Hauts-de-France ou encore l’île de La Réunion. Les contenus de ces rapports s’appuient sur des « méthodes qualitatives » d’enquête (observations, entretiens). Elles sont menées auprès d’acteurs-rices divers-ses (usagers-ères, intervenants-es du secteur socio-sanitaire et de l’application de la loi, etc.) locaux-les ; ce qui contribue à une « meilleure compréhension des spécificités territoriales. »
Récemment, l’OFDT (Observatoire français des drogues et des tendances addictives) a publié neuf rapports. Ils présentent des données de 2024. Ces rapports sont centrés sur les grandes métropoles régionales, mais abordent aussi les situations régionales. Les rapports sont tous construits sur le même modèle : méthodologie, objectifs, provenance des données analysées, les tendances régionales (ventes, trafic, consommations), les tendances sur les produits et les tendances sur les usages. L’actu vue par Remaides a choisi, dans cet article, de synthétiser des informations relatives à la pratique du chemsex et a retenu plusieurs grandes villes : Bordeaux, Paris, Marseille et Lyon. Les autres apports (Rennes, Lille, La Réunion, etc.) sont accessibles et consultables sur le site de l’OFDT. Cette synthèse n’aborde pas l’ensemble des données et constats largement analysés dans les différents rapports, mais quelques points saillants.
Lyon, sa région et les pratiques de chemsex
D’emblée, le rapport de l’OFDT pose que le « recours à l’usage de produit dans un cadre sexuel et quelle que soit l’orientation sexuelle (homo ou hétérosexualité) des personnes, est peu documenté à l’exception des pratiques de chemsex qui font l’objet d’investigations spécifiques. »
Les investigations menées en 2023 pour une précédente édition du rapport exposaient les différents contextes de sexualité où l’usage de produits pouvait apparaitre (sexualité collective/sex-party, ou en binôme, couple ou non). Dans ce cadre toujours, les principaux produits cités restent le cannabis, la cocaïne, l’ecstasy et les cathinones, parfois également la kétamine, et plus rarement le GHB/GBL, indique la dernière version du rapport. Comme on l’imagine, les motivations à l’usage sont multiples : de la désinhibition et la « recherche de sensations accrues de plaisir », à la « volonté d’anesthésier une partie de sa conscience et de ses sensations corporelles, en lien ou non avec des difficultés relationnelles, sexuelles, issues de divers traumatismes. »
L’association d’auto-support Keep-smiling a mené une étude en 2024 sur les liens entre consommations de drogues et pratiques sexuelles, afin de pointer les facteurs socio-démographiques et individuels qui influent sur « la consommation sexualisée de produits psychoactifs ». L’enquête s’est notamment intéressée aux effets des produits sur la capacité à déterminer, exprimer, et respecter, le consentement. Elle fait apparaitre diverses motivations à l’usage : la désinhibition (pour 58 % des personnes répondant), la recherche de plaisir (45 %), et l’expérimentation de nouvelles pratiques sexuelles (35 %). Des variations importantes sont constatées en fonction du genre des répondants-es (par exemple, les usages relatifs à la gestion des traumatismes sont mentionnés pour plus de la moitié des répondants-es transgenres, contre 10 % des hommes cisgenre et 24 % des femmes cisgenre).
Les profils des personnes pratiquant le chemsex sont toujours variés en termes d’âges (entre 20 et 50 ans en majorité mais parfois plus jeunes ou plus âgés) ainsi que d’origines et de conditions sociales. « À ce propos un certain nombre de chemsexeurs rencontrés sont étudiants », précise le rapport. Leurs modalités d’engagement dans les pratiques de chemsex sont diverses, avec des liens communautaires plus ou moins resserrés, de même que leur entrée dans la pratique et leurs motivations à celle-ci : exutoire face à une activité professionnelle intense ou au contraire du fait de la vacance liée à l’absence d’emploi, lien avec le travail du sexe (comme escort ou comme client), histoire personnelle/amoureuse ayant conduit à l’expérimentation ou au contraire à l’arrêt des consommations, etc. Les plus jeunes d’entre eux ont pu parfois faire leur entrée dans la sexualité avec des pratiques de chemsex, et leur jeune âge lors des consultations est souligné par des intervenants-es auditionnés-es lors de la réalisation dudit rapport.
En grande majorité, les personnes pratiquant le chemsex rencontrées dans les structures d’accompagnement (Csapa/Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, Caarud/Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues, centres de santé sexuelle) prennent la Prep (prophylaxie pré-exposition) de manière continue ou discontinue, ou sont séropositives au VIH et sous traitement.
Concernant les produits consommés, ceux-ci restent en majorité centrés sur le trio GBL-cathinones et kétamine. Ils peuvent parfois être directement mélangés pour obtenir des effets spécifiques, qu’ils soient consommés en ingestion (GBL, plus rarement cathinones) ou en sniff (cathinones et kétamine) en injection (cathinones) et plus rarement en plug (GBL, cathinones). S’agissant de la kétamine, son usage est devenu régulier dans les pratiques de chemsex alors qu’il était plus occasionnel par le passé, et la kétamine est également consommée parfois sur des temps annexes. De nombreux usagers de chemsex, à l’instar d’usagers-ères des espaces festifs, utilisent pour toutes les cathinones la dénomination « 3 » en référence à la 3-MMC, mais sans qu’il s’agisse toujours de cette molécule, la poudre pouvant aussi être de la 3-CMC ou encore d’autres cathinones. De plus en plus d’usagers indiquent consommer de la 2-MMC ou de la NEP (N-Ethylpentedrone, une autre sorte de cathinone) regrettant généralement des effets moins appréciables que la 3-MMC qu’ils ont pu connaitre. Les espaces dans lesquels peuvent avoir lieu des pratiques de chemsex restent tout à fait similaires aux années précédentes. Ces pratiques sont principalement documentées sur la région lyonnaise, sachant que les chemsexeurs résidant dans de plus petites villes ou en milieu rural se déplacent généralement dans les plus grandes agglomérations de la région ou plus loin selon où ils résident (Genève, Nîmes, Marseille).
Ces espaces sont principalement : des appartements privés, où la plupart des « plans » qui réunissent plusieurs personnes se déroulent désormais avec l’usage de produits.
Les problématiques sanitaires qui peuvent survenir pour certains-es usagers-ères concernent principalement les surdosages de GBL et de kétamine, les dommages corporels liées à l’injection de cathinones, les infections virales. Les autres problématiques sont d’ordre psychiques (développement d’une addiction aux produits et aux applications de rencontre en lien parfois avec un trouble de la sexualité, dépression et autres problèmes de santé mentale) et sociales (violences subies, dettes, mise à mal de lien sociaux, etc.). Les G-hole sont très régulièrement rapportés, par des chemsexeurs les ayant vécus ou y ayant assisté, par des soignants-es les rencontrant.
Les surdosages de kétamine sont aussi rapportés, générant les mêmes mesures de prise en charge, ou non, des usagers-ères. Elles résultent souvent d’une confusion entre le dosage de la cocaïne et celui de la kétamine, ou encore d’une inversion des produits par accident.
Des problématiques liées aux injections sont toujours constatées, que celles-ci soient réalisées au niveau des bras, des jambes, voire des pieds et des mains. Le manque d’accès aux kits d’injection à moindre risque et d’une manière générale à tout le matériel de consommation, est fréquemmentrapporté par des usagers. Ceux-ci ne connaissent pas toujours l’existence ou le fonctionnement des Caarud, ni l’accueil qui peut leur être réservé, de même que dans les pharmacies. Le peu de maitrise des gestes ou l’absence de transmission entre pairs, ainsi que la forte corrosivité des produits, entrainent des problèmes veineux importants (abcès, thromboses). Dans certaines soirées, des personnes peinant de longues minutes avant de réussir à s’injecter.
Les problématiques liées à la dépendance physique et psychique qui peut s’installer pour divers produits sont toujours rapportées. C’est notamment le cas pour les cathinones et le GHB/GBL, lequel nécessite parfois un sevrage hospitalier afin de réduire les risques sanitaires associés à son arrêt (à l’instar de l’alcool dont les symptômes de sevrage sont proches). Cette prise en charge n’est pas toujours évidente, les services et notamment les cliniques où peuvent s’adresser les usagers ne s’estimant pas toujours compétents sur le sujet. Les personnes se trouvent alors en grande souffrance face à cette problématique sanitaire cruciale non prise en charge.
Des infections virales (VIH, VHC et VHB notamment) « résultant du partage de matériel ou de rapports non protégés [avec] des personnes séropositives sans traitement, sont toujours rapportées. La difficulté d’accès à la Prep pour les personnes exilées n’ayant pas d’AME est à ce sujet une problématique de santé publique notable, alors que la Prep est très diffusée chez les chemsexeurs par ailleurs. Les autres IST (syphilis, chlamydia, gonorrhées, etc.) sont toujours mentionnées et généralement prises en charge par les Cegidd (centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par le VIH et les hépatites virales et les infections sexuellement transmissibles) sans difficultés majeures. Ces derniers développent de plus en plus de partenariats avec les Csapa et Caarud.
La prise en charge aux urgences psychiatriques, suites à des cessions de consommations entrainant une grande détresse psychique, est parfois compliquée. En effet, les services n’acceptent généralement pas de recevoir des personnes encore sous l’effet de produits, et les urgences somatiques vers lesquelles ils sont alors orientés n’ont pas toujours de psychiatre disponible. Face à toutes ces problématiques et difficultés d’accès aux soins et au matériel de consommation à moindre risque, les services d’addictologie et de santé communautaire tentent de développer des modalités d’accompagnement diversifiées et les plus accessibles possibles. Ainsi, à Lyon, l’association AIDES a pu mettre en place des permanences nocturnes certains soirs, ainsi que des consultations par visio et des contacts via les applications (« allez-vers numérique ») ; un centre de santé sexuelle a créé un groupe de parole à destination de chemsexeurs ; un service d’hôpital de jour dédié au chemsex va ouvrir prochainement, et d’autres initiatives ont lieu ailleurs en région.
Bordeaux, sa région et les pratiques de chemsex
À l’image des éléments rapportés les années précédentes, les chemsexeurs sont des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH), majoritairement blancs, d’âges variés (de 16 à 70 ans), et des profils socioéconomiques plus favorisés que les autres publics fréquentant les structures de réduction des risques, explique le rapport de l’OFDT. Certaines personnes usagères en situation de grande précarité témoignent néanmoins de trajectoires de perte de contrôle de l’usage engendrant une désinsertion sociale. Des personnes transgenres sont également identifiées. La moyenne d’âge des chemsexeurs fréquentant les Csapa et les Caarud est de 45 ans. L’usage des applications de rencontre est toujours très important pour rencontrer des partenaires et organiser des soirées. Le rapport note des « usages qui se concentrent toujours autour des cathinones et du GHB/GBL ». Sans que cela ne constitue une tendance nouvelle, les chemsexeurs consomment toujours principalement des cathinones (3-MMC et dérivés) et du GBL, ainsi que de la cocaïne (sniffée, et dans une moindre mesure injectée ou basée), des médicaments érectiles (Viagra, Cialis, Sildénafil, etc.), du poppers, et dans une moindre mesure, de la kétamine et de l’ecstasy/MDMA. Les usages de GBL semblent davantage présents à Bordeaux. La méthamphétamine est toujours peu disponible, mais recherchée par les chemsexeurs dans la région.
La diversité des molécules de cathinones met toujours en difficulté les usagers, qui ne savent pasforcément ce qu’ils consomment, et les professionnels-les eux-elles -mêmes sont parfois démunis-es face à cette diversification des molécules, note l’OFDT. La 3-MMC semble peu disponible, comparée à la 2-MMC, la 3-CMC et la 4-MMC. La 3-MMC est actuellement très recherchée, l’effet étant décrit comme plus plaisant. Le slam est toujours présent en chemsex, essentiellement l’injection de cathinones et de cocaïne. Si la majorité des chemsexeurs qui fréquentent les Caarud le pratiquent, ce mode de consommation en contexte sexuel ne semble en revanche, pas être majoritaire, comparé à l’usage par voie nasale. Le passage au slam est présenté comme un élément important dans la trajectoire d’un chemsexeur, qui peut faire basculer la gestion de la consommation. Certains usagers prennent des risques importants.
Décès, prises de risques, pertes de contrôle de l’usage et complications post-injection. En 2024, cinq décès de chemsexeurs ont eu lieu dans la région, dont certains ont été rapportés dans la presse, après des consommations de cathinones, de GHB/GBL, de cocaïne, d’alcool, de poppers et de Sildenafil ou Tadalafil. Dans certains dossiers, certains usagers présents ayant assisté au décès ont été inculpés pour homicide involontaire, non-assistance à personne en danger et/ou trafic de stupéfiants. Des rapports sexuels non protégés, des fissures anales, des péritonites et infections virales (VIH, VHC) et des IST (chlamydia, gonorrhée, syphilis…) sont rapportées. Certains chemsexeurs sont sous prophylaxie pré-exposition (Prep) ou traitement post-exposition (TPE). En termes de complications post-injection, des abcès, des nécroses (notamment après des injections de 3-CMC), des phlébites et des ulcères chroniques sont toujours évoqués. Des problèmes cardiaques peuvent également être diagnostiqués. « Sans que cela ne constitue une nouveauté, les enjeux liés au consentement et au SPT [stress post traumatique] sont très présents au sein du public chemsex, avec des récits de viols ou d’agression sexuelle en contexte de vulnérabilité ou de soumission chimique, notamment avec le GBL et des cas de G-hole. Cela fait échos aux éléments déjà décrits sur le public LGBTQIA+ en Caarud (…) Ces abus peuvent entraîner un syndrome de stress post-traumatique (SSPT), qui peut renforcer les consommations, utilisées dans une visée, non plus uniquement de performance sexuelle, mais également à des fins autothérapeutiques et d’évasion. Certains usagers subissent des conséquences sanitaires délétères (fissure anale, éclatement du sphincter) liées à des pratiques sexuelles qu’ils n’auraient pas accepté "sobres". »
Comme en 2023, le recours à la prise en charge des chemsexeurs n’est pas la même dans les cinq villes investiguées : il est plus important à Bordeaux et dans les villes où les structures sont habituées à prendre en charge ces publics. Les dispositifs de santé communautaire semblent particulièrement efficaces, par exemple les groupes de paroles tels que développés dans un Caarud poitevin. Les professionnels-les de cette structure ont décidé de scinder ce groupe de parole en deux, l’un étant dédié aux usagers souhaitant être abstinents et l’autre pour ceux qui gèrent leurs consommations. L’instauration de ce type de prise en charge a permis d’orienter des chemsexeurs vers le Csapa, en faisant notamment intervenir une psychologue, et de faire connaître le Caarud, par effet de bouche-à-oreille. Dans les Caarud, les chemsexeurs viennent essentiellement chercher du matériel de consommation, solliciter une analyse de drogues, demander des soins pour des complications post-injection ou des conseils en réduction des risques (comment s’injecter, comment doser le GBL par exemple), ce qui s’inscrit dans une tendance nationale. Selon le rapport de l’OFDT, les priorités en termes de prise en charge pour ce public sont les suivantes : développer des services adaptés à leurs problématiques, en mobilisant l’aller vers (comme les maraudes numériques, l’affichage dans les saunas et les lieux de sociabilité et/ou de sexualité gay) et le milieu communautaire ; créer des réseaux de professionnels-les formés-es aux enjeux à la fois liés aux drogues et à la sexualité ; et maintenir le lien avec des personnes fréquemment discriminées et stigmatisées. Les chemsexeurs sont victimes de discriminations similaires à celles décrites concernant le public LGBTQIA+ qui fréquente les Caarud, au croisement de l’homophobie et de la toxicophobie, avec par exemple des réflexions sur la fréquentation de saunas ou le nombre de partenaires.
Marseille, sa région et les pratiques de chemsex
« Le dispositif actuel d’observations en PACA [Provence-Alpes- Côte d’Azur] ne nous permet pas de réaliser des observations directes d’usages de drogues en contexte chemsex », indique le rapport de l’OFDT, qui recueille cependant chaque année des témoignages de personnes ayant des pratiques de chemsex et d’intervenants-es auprès de personnes pratiquant le chemsex. La pratique de chemsex est réalisée le plus souvent dans des appartements privés, le plus fréquemment en week-end, pouvant durer jusqu’à 48 heures ou plus, et rassemblant plusieurs participants. Certaines villes de la Côte d’Azur (telles que Nice ou Cannes) semblent être fréquemment citées dans les offres de parties chemsex. Au point que des intervenants-es ou chemsexeurs ont évoqué des formes de « tourisme sexuel », parlant même de « sortes d’agences de voyages qui proposent à une clientèle aisée monégasque ou parisienne des week-ends chemsex sur la Côte d’Azur, en séjour tout compris. Les chemsexers représentent une population très diverse en termes d’âge, de position socioéconomique et même d’insertion dans les réseaux communautaires LGBTI+. « Tous les chemsexers interrogés de même que les intervenants en RdRD [réduction des risques liés aux drogues, ndlr] disent qu’une très grande majorité de chemsexeurs pratiquent sous Prep », indique le rapport.
Chaque année depuis 2019, les intervenants-es en Caarud signalent accueillir de nouvelles personnes venant chercher du matériel de consommation à moindres risques pour des parties de chemsex (notamment des seringues, en quantités importantes : jusqu’à 200 seringues par semaine pour certains…), et ce, y compris hors des métropoles. Mais le phénomène plus marquant est l’augmentation des demandes d’aide ou de soin en Csapa ou de sevrage en services hospitaliers ou en cliniques privées depuis 2021. Jusqu’en 2020 peu de Csapa en région PACA accueillaient plus spécifiquement ce public, souligne l’OFDT. Désormais toutes les structures, face au nombre croissant de sollicitations, ont soit déployé un accueil spécifique avec certains-es intervenants-es formés-es sur ces problématiques, soit se disent assez démunies face au manque de médecins et psychiatres spécialisés-es.
Les éléments nouvellement évoqués cette année témoignent de situations particulièrement préoccupantes du point de vue sanitaire : par exemple des addictions au GBL ― avec des personnes qui consomment des doses importantes quotidiennement ― et des décès apparemment liés à ces consommations. Mais aussi des arrivées aux urgences hospitalières ou psychiatriques, suite à des parties de chemsex.
Paris, sa région et les pratiques de chemsex
C’est un élément nouveau : la « visibilité en hausse de personne exilées parmi les usagers pratiquant le chemsex », indique le rapport de l’OFDT. Les profils des chemsexeurs décrits par le site TREND francilien recouvrent une importante diversité sociodémographique, en termes de ressources économiques, d’insertion sociale (travail, logement, couverture sociale), d’âge, de profession ou d’origine ethnoculturelle. La visibilité parmi ces profils de personnes exilées aux parcours migratoires plus ou moins récents continue de rompre avec l’image caricaturale du chemsexeur parisien socialement favorisé. La présence notamment de personnes originaires du Maghreb (…) ainsi que d’hommes originaires du Pendjab (Inde) parmi les files actives des Caarud et Csapa exerçant en Seine-Saint-Denis ainsi qu’en Essonne a été documentée pour la première fois en 2022. En 2024, Les observations font état d’une hausse de la visibilité de personnes exilées originaires d’Afrique du Nord et subsaharienne, de la corne de l’Afrique, ainsi que du Proche et Moyen-Orient parmi les usagers ayant des pratiques de chemsex.
À Paris, des Caarud rapportent des demandes de matériel d’injection par des hommes âgés de 20 à 50 ans, tandis que des Csapa et services hospitaliers de Seine-Saint-Denis décrivent des demandes de soin par des hommes de 25 à 45 ans. Des associations de santé communautaire à Paris comptent parmi les personnes qu’elles accompagnent des hommes exilés aux parcours migratoires récents, celles-ci constituant jusqu’à 30 % de la file active du SPOT Beaumarchais (AIDES). La présence de personnes en situation de migration pratiquant le chemsex dans la file active de certaines structures médicosociales aurait débuté après la crise sanitaire liée à la Covid-19, parfois plus récemment, indique le rapport. En Seine-Saint-Denis, plusieurs intervenants dans des Csapa et des services hospitaliers constatent une évolution de la manière dont s’identifie ce public particulier, les personnes exilées qu’ils accompagnent se définissant désormais plus aisément comme homosexuels, ainsi que comme chemsexeurs.
Une partie de ces patients est orientée en addictologie suite à un passage par les services d’urgence pour des complications liées à l’injection ou des surdoses. Toutefois les demandes d’accompagnement en lien avec les pratiques de chemsex exprimées directement aux structures d’addictologie sont plus fréquentes. Parmi les patients reçus dans ces services, les chemsexeurs en situation de migration qui ont recours aux pratiques d’injection se présentent et s’auto-désignent beaucoup moins comme « slameurs ». Ils abordent d’emblée leur pratique sous l’angle de l’injection plutôt que du slam. Cette évolution des représentations et de la façon de s’autodéfinir va de pair avec une meilleure appropriation des outils de RdRD par les personnes, qui ont gagné en autonomie vis-à-vis de leurs pratiques.
La présence récente dans leur file active de jeunes hommes exilés interroge des intervenants de structures de RdRD, notamment l’une d’elles située à Paris où un nouveau groupe de consommateurs âgés d’une vingtaine d’années, originaires d’Afrique du Nord et en situation de grande précarité, vient se fournir en matériel d’injection. Ils peinent à comprendre leurs pratiques et les rapports qu’ils entretiennent avec des hommes plus âgés (50 à 60 ans), le contact avec eux étant difficile à établir. Ces interrogations concernent la place des échanges économico-sexuels, les rapports de dominations et la question du consentement. Ces intervenants font également part de leurs préoccupations à propos de situations de soumission chimique et de violences sexuelles subies par ces jeunes hommes.
Si les données collectées en 2024 mettent en lumière des niveaux d’insertion sociale et de ressources hétérogènes chez les chemsexeurs, à Paris et en Seine-Saint-Denis, plusieurs acteurs de la santé communautaire, de la RdRD et de l’addictologie, ainsi que des chemsexeurs, évoquent un phénomène de précarisation du public. D’une part, des intervenants-es observent l’arrivée dans leur file active de nouvelles personnes, déjà engagées dans des pratiques de chemsex et particulièrement « éloignées de tout », selon les propos d’une professionnelle d’un Caarud parisien. D’autre part, des chemsexeurs connus de leurs services, bénéficiant d’un accompagnement – parfois depuis plusieurs années – sont pris dans des processus de précarisation d’une ampleur inédite. Ces différents-es acteurs-rices décrivent des situations de « dégringolades sociales » particulièrement « vertigineuses », plus fréquentes et plus rapides qu’auparavant. Un intervenant de santé communautaire à Paris relate plusieurs situations où des personnes perdent tout type de ressources en deux ou trois années de pratiques de chemsex.
Le parallèle avec l’épidémie de VIH/sida, qui dans les années 1980-1990 a particulièrement frappé les hommes gays et les usagers de drogues par voie intraveineuse, est très rapidement établi par des chemsexeurs ayant connu cette période qui a marqué leurs esprits. « Pour moi, même si ce que je dis est fort, il y a un côté épidémie. C’est comme le sida. Par exemple, aux États-Unis, les opioïdes tuent plus que le sida à ses pires moments. Je pense qu’on sous-estime beaucoup les cathinones. Je pense qu’on sous-estime beaucoup la catastrophe sanitaire que ça entraîne. J’ai vu des gens tout perdre. J’ai vu des gens se dégrader physiquement de manière hallucinante en un an. Je vois aussi des gens qui ont un mal-être psychologique. Disons que ça a vrillé, c’est devenu une épidémie », explique ainsi un usager chemsexeur parisien.
Ce que certaines personnes qualifient d’épidémie dépasse, selon elles, largement la question du risque infectieux lié à l’injection et à la sexualité gay, deux marqueurs forts de certaines pratiques de chemsex. Les discours décrivent un phénomène marqué par un mal-être profond, fait de désenchantement et de désillusions qu’ils situent dans la droite lignée des « années sida ». Aux conditions de vie matérielles et aux difficultés économiques que rencontrent un nombre grandissant de chemsexeurs, s’ajoutent des inquiétudes beaucoup plus larges et anxiogènes qui ne sont pas l’apanage des seuls chemsexeurs – le dérèglement climatique, la montée de l’extrême droite, la condition salariale…
Les situations rapportées font apparaître chez les usagers qui les vivent d’importantes fragilités psychologiques, sociales, voire les deux à la fois, ceux-ci se retrouvant alors pris dans un engrenage qui les fait plonger très rapidement, pointe le rapport. Ces problématiques dépassent largement celles liées à la pratique du chemsex et mettent les équipes des structures de RDRD, de santé communautaire et les services d’addictologie en difficulté. Elles amènent certaines structures à adapter leur offre en direction des publics chemsexeurs, sans toujours parvenir à répondre à des besoins qui évoluent en permanence. « Selon des acteurs de terrain intervenant auprès des chemsexeurs les plus en difficultés, l’offre de prise en charge centrée sur le chemsex néglige des usagers qui sont plus concernés par des problématiques psychologiques ou sociales nécessitant une prise en charge antérieure. À l’instar d’autres usages de substances observés dans d’autres espaces et par d’autres populations, sont associées au chemsex des problématiques qui n’en relèvent finalement pas tant. »
Sources :
TREND. Substances psychoactives, usagers et marchés tendances récentes à Marseille et en Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2024. Par Claire Duport (Addiction Méditerranée), avec les contributions de Vincent Castelas, Arthur Durand et Baptiste Mercier.
TREND. Substances psychoactives, usagers et marchés tendances récentes à Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes en 2024. Par Nina Tissot (Oppelia-RuptureS).
TREND. Substances psychoactives, usagers et marchés tendances récentes à Paris et en Île-de-France en 2024. Par Justine Klingelschmidt, Mathieu Lovera et Grégory Pfau (Oppelia-Charonne).
TREND. Substances psychoactives, usagers et marchés tendances récentes à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine en 2024. Par Sarah Perrin (CEID Addictions).
Glossaire
Les produits et effets
Cathinones : les cathinones sont une famille de substances de synthèse dérivées de la cathinone naturelle (un des principes actifs du khat). Les plus connues sont la 3-CMC, la 3-MMC, la méphédrone, la 4-MEC, la MDPV, et l’alpha-PVP.
Ecstasy : Le nom chimique de l'ecstasy est 3,4-méthylènedioxyméthamphétamine, abrégé en MDMA. La composition chimique et les effets de la MDMA sont similaires à ceux de l'amphétamine (un stimulant) et de la mescaline (un hallucinogène).
GHB/GBL : Le GHB (gammahydroxybutyrate) est à l’origine un anesthésiant utilisé en médecine pour ses qualités sédatives (calmant). Le GBL (gamma-butyrolactone), moins courant, est un produit chimique utilisé comme solvant-décapant. Il se transforme dans le corps, après absorption, principalement en GHB. C’est pourquoi on dit que le GBL un précurseur du GHB, et qu’ils ont les mêmes effets.
Kétamine : La kétamine est un psychotrope utilisé comme anesthésique injectable. Elle est aussi employée comme analgésique, sédatif, et en médecine vétérinaire.
G-hole : Un G-hole est un état de coma ((trou noir, perte de mémoire, de connaissance comme si l'on était sous anesthésie) provoqué par un surdosage de GHB/GBL qui dure généralement une à deux heures. On ne se réveille pas toujours d'un G-hole.
Les structures
Caarud : centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues.
Cegidd : centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par le VIH et les hépatites virales et les infections sexuellement transmissibles.
Csapa : centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie.
OFDT : Observatoire français des drogues et des tendances addictives
TREND : Tendances récentes et nouvelles drogues, un dispositif d’observation de l’OFDT.
